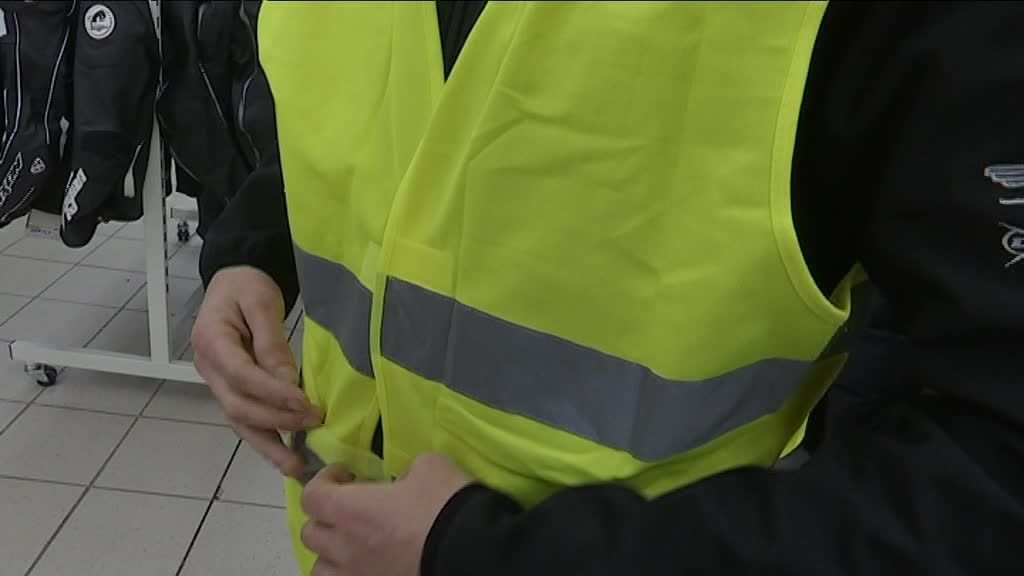Déclaration de la Ligue Alegerienne Des Droits de l’Homme sur le procès d’Adlène Mellah
DÉCLARATION
Le bureau d’Oran de la LADDH a pu suivre de près les péripéties lors du procès du journaliste Adlène Mellah, du journaliste photographe Abdelaziz Laadjel et de l’homme de théâtre Abdelhafid Nekrouch. Le collectif des avocats et avocates qui a eu à cœur de les défendre n’ont pas pu bénéficier du droit à défendre leurs clients comme les accusés n’ont pas eu le droit à la défense tel que prescrit par la constitution, premier texte de la république Algérienne.
Le bureau d’Oran considère que ce qui s’est passé est révélateur de l’instrumentalisation de la justice et de l’omnipotence du pouvoir réel en Algérie sur les institutions, les textes et les principes.
Le Bureau d’Oran considère l’attitude du collectif des avocats et avocates comme preuve que la corporation des avocats peut et doit regagner toute sa place en tant que partenaire indépassable au sein du secteur de la justice. Il espère voir d’autres avocats s’engager pour défendre le droit auprès des multiples victimes de la répression.
Le Bureau d’Oran ne peut ignorer la présence massive de militants et militantes, de citoyens et de citoyennes lors de ce procès et espère que dorénavant cela sera la règle dans de tels procès. C’est par cette solidarité que nous récupérerons notre pays et rendrons à la justice toute sa place en tant que vrai pouvoir judiciaire indépendant.
C’est dans ce sens que le Bureau d’Oran espère voir ceux et celles qui partagent cette vision se joindre à nous lors du rassemblement qui se tiendra à partir de 10 h au sein de square Saïd à Oran le 22-12-2018.
Oran le 18-12-2018 P/ Bureau LADDH
Kaddour CHOUICHA