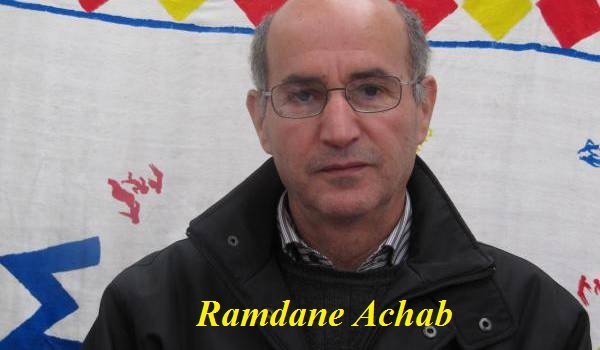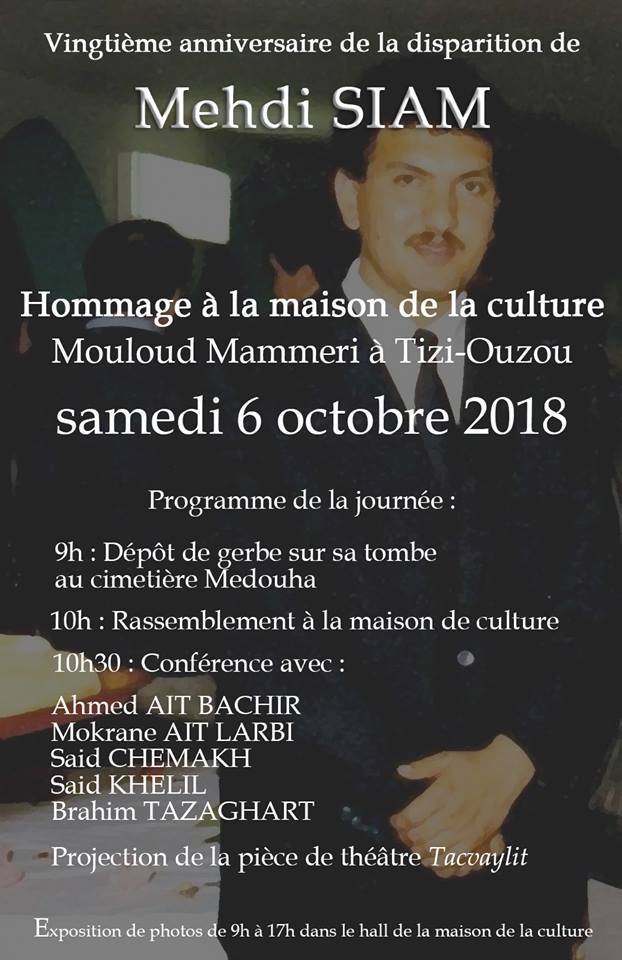Lisez la première partie
L’État algérien face à la revendication berbère et à ses outils (éditions, médias…)
- Les outils de la revendication (médias, édition…)
Les deux périodes suivantes se dégagent assez nettement : Avant l’ « ouverture politique » de 1989 ; Après l’ « ouverture politique » de 1989.
5 a) Outils de la revendication avant l’ « ouverture politique » de 1989
Dans les premières années de l’indépendance, l’identité berbère était taboue, mais l’hostilité envers elle ne faisait pas l’ombre d’un doute au plus haut sommet du pouvoir. Ben Bella livre les opposants Touaregs maliens à Modibo Keita. Le gouvernement algérien s’applique à détruire les liens entre les Touaregs du nord et du sud1. La règle d’or du pouvoir politique est le silence absolu, consolidé par la peur, la censure, l’autocensure et toutes sortes de culpabilités héritées de l’histoire et savamment entretenues.
Mais la société n’est pas totalement soumise, surtout que les déceptions et les frustrations de l’indépendance sont nombreuses, sur les questions de l’identité bien sûr, mais aussi en matière de démocratie et de libertés individuelles et collectives. Le sentiment identitaire berbère est bien réel, et pas seulement en Kabylie, même s’il n’est pas toujours formulé de façon très nette par le plus grand nombre. Des chanteurs, des poètes, des intellectuels sont là pour le faire. Ces déceptions, ces frustrations et ce sentiment identitaire vont nourrir en sourdine une révolte qu’il est possible de retracer à travers un certain nombre de faits, d’événements, de jalons et d’ancrages : la rébellion armée du FFS en 1963 (bien que ne portant pas sur la revendication identitaire de façon explicite, mais sur la démocratie de façon générale) et la répression qui s’en est suivie ; le travail de conscientisation, discret mais efficace, de quelques journalistes de la radio kabyle d’Alger ; les cours de berbère de Mouloud Mammeri à l’Université d’Alger et son activité de recherche au sein du CRAPE, en ce qu’ils ont permis d’initier un nombre relativement important de personnes au domaine berbère (langue, culture, civilisation), mais aussi en ce qu’ils ont donné lieu à des rencontres fertiles et durables ; la naissance de la néo-chanson kabyle, identitaire et contestataire, au début des années 1970 ; le travail de conscientisation fait par les étudiants autour des cours de Mammeri (théâtre, excursions, activités culturelles organisées par les comités de cités universitaires2) ; la production d’œuvres littéraires importantes (poésie, théâtre…) ; l’apparition de bulletins culturels clandestins dans la capitale dans les années 1970 ; certaines expressions de colère, de révolte et de défi comme à l’occasion de la fête des cerises de Larbaa-Nath-Irathen en 1974 et la finale de la coupe d’Algérie de football en 1977 ; les débats autour de la Charte nationale de 1976 qui ont donné l’occasion de poser publiquement la question de la place de la langue berbère en Algérie ; l’affaire dite des « poseurs de bombes » au cours de laquelle de jeunes militants berbères structurés dans l’ADEF3 et l’OFB4 proches de l’Académie berbère sont passés à l’action
————————————————————–
1 Claudot-Hawad (Hélène), 1987. – Des Etats-Nations contre un peuple : le cas des Touaregs. In : Berbères : une identité en construction (sous la responsabilité de Salem Chaker). Aix-en-Provence : Edisud.
2 Dès la fin des années 1960 se créent à la cité universitaire de Ben Aknoun le Centre de culture berbère et le Centre Dramatique universitaire. En 1973, une troupe de théâtre jouera à Tunis une traduction en kabyle de Mohamed prends ta valise de Kateb Yacine, dans le cadre d’un festival international de théâtre universitaire. La même pièce sera jouée à Tigzirt en plein air, au milieu des ruines romaines, ainsi qu’à la salle de cinéma de Boghni à l’occasion de sorties culturelles organisées autour des cours de Mammeri. L’activité théâtrale en général, écriture et mise en scène, a toujours suscité un certain engouement de la part des lycéens et des étudiants notamment. A titre d’exemples (Source : Salah Oudahar), les pièces de théâtre en français montées au tout début des années 1970 au lycée Amirouche de Tizi-Ouzou (la déchirure, la valise ou le cercueil).
3 ADEF : Afus deg ufus (la main dans la main).
4 OFB : Organisation des forces berbères. Les militants arrêtés furent condamnés à de très lourdes peines de prison. Si plusieurs témoignages existent aujourd’hui sur cette « affaire », un aspect reste toujours tabou : la très probable infiltration du groupe par les polices française et algérienne. Les « bombes » n’ont occasionné que des dégâts matériels mineurs, mais « l’affaire » a donné lieu en Algérie à une exploitation médiatique disproportionnée, à des fins de stigmatisation de la chose berbère et de manipulation de l’opinion.
——————————————————
violente (1976) ; le travail des partis d’opposition clandestins, le FFS notamment, en Kabylie et dans l’Algérois vers la fin des années 1970 ; et, enfin, le printemps berbère de 1980 (marches des mois de mars et d’avril 1980, grève générale du 16 avril 1980, répression du 20 avril, etc.) que l’on considère désormais comme l’acte fondateur de la revendication berbère, en ce qu’il a donné lieu aux grandes manifestations publiques en faveur de la berbérité et inauguré, pour l’Algérie entière et pour les pays voisins, l’ère de la remise en cause, de la contestation et de la révolte.
C’est dire aussi que les événements de 1980 ne sont pas tombés du ciel, mais qu’ils ont été précédés, préparés par toute une série d’autres événements qui se sont étalés sur la longue durée. Que l’on précise bien cependant que, sur cette longue durée, il n’y avait pas de pôle organisationnel unique. Une multitude de pôles plutôt, avec une certaine mobilité des acteurs d’un pôle à l’autre, d’une période à l’autre, d’un pays à l’autre (Algérie-France). A l’approche du printemps berbère de 1980, la présence en Kabylie et dans l’Algérois de structures politiques clandestines d’opposition (FFS, PRS, FUAA, extrême-gauche, etc.) a été d’un apport relativement important dans le travail de structuration de la société d’une part, et d’encadrement du mouvement d’autre part. A titre d’exemples, les appels à la marche du 7 avril 1980 à Alger et à la grève générale du 16 avril 1980 ont été lancés par des militants du FFS clandestin, sous couvert de signatures de circonstance (comité de soutien aux étudiants en grève). Les événements de 1980 ont été aussi, on ne l’a pas toujours souligné, une école du compromis et de la responsabilité, la première expérience de multipartisme jamais faite en Algérie : à l’université de Tizi-Ouzou, les grandes orientations du mouvement, les décisions, les déclarations étaient le résultat de discussions très serrées et contradictoires en assemblée générale. Le caractère pacifique du mouvement a toujours été rappelé avec insistance, rappelé, apprécié et respecté, qualité essentielle dont ne peuvent se réclamer d’autres événements, d’autres moments, ceux de 2001 par exemple que la tradition berbériste inscrit trop rapidement dans la même lignée. On n’a pas toujours souligné non plus la présence de militants arabophones, dont quelques enseignants (cadres du PRS) à l’université de Tizi-Ouzou qui ont assumé jusqu’au bout, jusqu’à l’arrestation et la torture, le combat identitaire et la revendication des libertés démocratiques et de la justice sociale.
Bien évidemment, la présence et l’expression de la berbérité ne se limitaient pas à ces événements. La berbérité au sens large du terme s’exprimait quotidiennement par tous les pores de la société, elle en était à la fois la respiration la plus immédiate et la plus profonde, de l’expression linguistique à l’organisation sociale, en passant par les pratiques culturelles, les rites, les croyances, etc. Elle était également non seulement présente mais essentielle, dans l’œuvre des écrivains, des chanteurs, des artistes d’une façon générale.
Au sein de la diaspora en France, et à partir de celle-ci en direction notamment de l’Algérie et du Maroc, il y avait aussi le travail de conscientisation fait par l’Académie berbère de Paris à partir de la fin des années 1960, les enseignements académiques de linguistique berbère (EPHE, Inalco), les activités d’enseignement, d’animation1 et de publication du Groupe d’Etudes Berbères (GEB) de l’Université Paris VIII-Vincennes (années 1970), les articles de Mbarek Redjala dans Les temps modernes et L’homme et la société, un travail d’animation culturelle à travers le théâtre2 et la chanson, la production culturelle de la Coopérative Imedyazen de Paris à partir de la fin des années 1970, quelques articles de presse (Libération), etc.3 A l’étranger, c’est l’Amicale des Algériens en Europe, prolongement du parti unique au pouvoir, qui fait le travail de contrôle et de surveillance de la communauté émigrée.
Toujours avant 1980 au sein de l’immigration mais sur un terrain plus politique, il y avait aussi les activités de structuration, de formation et de propagande du FFS et du PRS, sans oublier de signaler le travail des trotskystes algériens1 qui se positionnaient sans complexe aucun en faveur de la langue berbère. Rejoint par un nombre important de membres du GEB ainsi que par les militants du « groupe d’Alger », le FFS clandestin se prononce en 19792 en faveur d’un statut de langue nationale pour la langue berbère, après une prise de position de Hocine Aït-Ahmed sur une chaîne de télévision française.
Le printemps berbère de 1980 allait connaître des prolongements et des répercussions sur la longue durée dans tous les pays d’Afrique du nord et au sein des diasporas berbères.
Localement, en Kabylie et dans l’Algérois, des cours non officiels de langue berbère, sont organisés au sein de l’université de Tizi-Ouzou3 occupée par la communauté universitaire, à Yakouren au mois d’août 1980 à l’occasion du séminaire destiné à l’élaboration du Dossier culturel, ainsi que dans quelques établissements à partir de la rentrée 1980 (campus de Oued Aïssi et de Hasnaoua, Université de Bab-Ezzouar (collectif Imedyazen), à Boumerdès, au Lycée de Draa- el-Mizan, etc. Une expérience de cours par correspondance sera même tentée en 1981, après l’interdiction de l’université d’été qui avait programmé une session de formation de formateurs, interdiction consécutive à l’occupation du campus universitaire de Oued Aïssi par l’armée qui y avait déployé quelques chars (été 1981).
Dans le domaine littéraire, on assiste dans les années 1980 à de nouvelles incursions dans des genres nouveaux tels que le roman, après les premières expériences modernes d’écriture que l’on peut faire remonter aux années 1950 ou même au début du 20ème siècle.
Face à cette montée en puissance de la revendication berbère, sur près de vingt ans, l’Etat algérien a usé des armes de l’intimidation, de la provocation, de la calomnie, de la répression, de la torture physique et morale à l’occasion des arrestations, de juridictions d’exception et de mesures de détention, sans jamais rien céder quant au fond pendant toute cette période.
S’agissant de l’édition et des médias, il faut distinguer les deux versants : le versant étatique ou officiel, et celui de la revendication berbère. Signalons aussi que la France a toujours servi de base arrière, notamment pendant les périodes d’interdiction ou de répression en Algérie.
Edition étatique
En Algérie, l’édition a été placée sous le contrôle étroit de l’Etat pendant plusieurs décennies. La SNED, Société Nationale d’Edition et de Diffusion, exerçait dans ce domaine un quasi-monopole sur toutes les publications destinées au grand public. Pour les besoins spécifiquement universitaires, la mission éditoriale était dévolue à l’OPU, l’Office des publications universitaires, également sous le contrôle de l’Etat. Destinés à l’école publique, la seule qui existait
—————————————————————-
1 Sous forme de conférences dans l’enceinte universitaire.
2 La troupe de théâtre Imesdurar animée par Mohia a participé à Suresnes au 1er Festival de Théâtre Populaire des Travailleurs Immigrés (juin 1975).
3 Cette présentation sous forme de liste pourrait laisser croire à une certaine unanimité dans les façons de voir les choses. S’il y avait consensus sur ce qui à l’époque représentait l’essentiel (travail de sensibilisation et de production notamment), les acteurs n’étaient pas tous logés à la même enseigne sur les plans idéologiques et politiques. Les différences étaient en particulier assez nettes entre la ligne de l’Académie berbère et celle du Groupe d’Etudes Berbères de l’Université Paris VIII-Vincennes ou bien des auteurs de la « contre-charte » qui a circulé à Alger en 1976. Ces différences se trouvaient certes à l’état latent, elles étaient vécues de façon plutôt passive et ne s’exprimaient qu’exceptionnellement sur le terrain, mais elles n’en constituent pas moins, et sur le long terme, une question taboue qu’il faut intégrer dans une analyse plus fine et politiquement plus différenciée du mouvement de revendication berbère. 1 CLTA : comité de liaison des trotskystes algériens.
2 Dans l’avant-projet de plateforme politique intitulé : « Pour une alternative démocratique révolutionnaire à la catastrophe nationale », mars 1979.
3 Le 1er cours a été donné par moi-même le 16 avril 1980.
——————————————————————-
jusqu’à une époque récente, les manuels scolaires étaient, eux, élaborés par le Ministère de l’éducation nationale. Pour toutes ces publications, les deux langues utilisées étaient l’arabe classique et le français.
Le contrôle de l’Etat signifie avant tout le contrôle strict des contenus et de l’instrument linguistique, la censure, l’autocensure de la part des auteurs, la promotion des écrits serviles, etc. Aucun écart, aucune contestation, aucune dissonance par rapport aux options idéologiques officielles ou aux choix politiques du pouvoir n’étaient non seulement permis, mais envisageables. L’importation d’ouvrages publiés à l’étranger était également le fait de services étatiques : elle était soumise aux mêmes types de contrôle.
Le contrôle de l’instrument linguistique était particulièrement sévère, voire sans appel. Dans les premières décennies de l’indépendance (1962) du pays, il était tout simplement inconcevable pour un Algérien berbérophone de publier le moindre écrit dans sa langue, en Algérie, quel que soit son contenu. Quelques rares auteurs qui ont eu l’outrecuidance de proposer leurs manuscrits berbères à la SNED se sont vu répondre négativement par… le département des langues étrangères.
Exceptions
Quelques rares exceptions seulement ont pu échapper à ce contrôle que les pouvoirs publics ont exercé sur l’activité éditoriale dans son ensemble, avant l’ouverture politique de 1989 et la libéralisation du secteur de l’édition :
- Les publications du Fichier de Documentation Berbère (FDB), créé en 1946 par des missionnaires religieux, les Pères Blancs. Le FDB allait assurer pendant une trentaine d’années, jusqu’à son interdiction en 1976 et la mise sous scellés de ses locaux par le Ministère algérien de l’intérieur, la publication de plusieurs dizaines de fascicules, généralement bilingues (berbère-français) portant sur la langue, la culture et la société berbères. La plupart des publications concernent la Kabylie, quelques autres ont porté sur d’autres régions berbérophones (Mzab, Ouargla, Ghadamès). Signalons au passage que ce sont les animateurs du FDB qui sont à l’origine des principes de base de l’orthographe actuelle du berbère en caractères latins, orthographe qui a subi par la suite un certain nombre de modifications ;
- L’Amawal (lexique de termes modernes) imprimé au CRAPE (Alger) en 1974 ;
- Le Dossier culturel issu du séminaire de Yakouren (août 1980). Ronéoté en Algérie à la rentrée 1980 (et publié ensuite en France par la coopérative Imedyazen sous le titre : Algérie : quelle identité ?) ;
- Un livre de poésies mozabites : Imeṭṭawen n lfeṛḥ (larmes de joie), publié à Ghardaïa en
Edition du côté de la revendication berbère
Les exceptions signalées précédemment mises à part, l’édition berbérisante se fait à l’extérieur du pays, en France surtout, qu’il s’agisse de la production académique (Mammeri, Chaker, Tassadit Yacine, berbérisants étrangers, etc.) ou de la production militante.
- Les quelques publications de la Coopérative Imedyazen de Paris, coopérative financée par le FFS et animée par des membres du GEB : un manuel d’initiation à la notation de la langue berbère en caractères latins (reproduit plus tard en Algérie en milieu associatif)1, une bande dessinée (Briruc)2, un conte (Tafunast igujilen)3, l’Amawal (lexique de termes modernes)1, le premier 33 tours de Ferhat-Imazighen Imula, le Dossier culturel de Yakouren ;
—————————————————————–
1 Auteur : Ramdane Achab (Groupe d’Etudes Berbères).
2 Auteur : Arezki Graïne.
3 Une version du célèbre conte, à partir d’un récit enregistré fait par Mme Ferroudja Sadi. Sur ce récit sont ensuite intervenus Mohia et Malika Chertouk. D’autres versions du même conte ont été également mises à contribution.
——————————————————————
- La néo-chanson identitaire et contestataire : (Idir, Ferhat, Mennad, Matoub, Aït Menguellet, etc.) Une néo-chanson qui s’ajoute à la production des chanteurs des générations précédentes (Slimane Azem notamment dans le domaine de la contestation et de la critique sociale) ;
- Cassettes de Muhend-u-Yahia (en reproduction libre dans un premier temps, éditées ensuite par les éditions Iles / Fnar de Paris) : poésie, critique sociale,
Médias du côté de l’Etat algérien
- Journaux et revues sont écrits en arabe ou en français. Médias aux ordres soumis à un contrôle strict des contenus ;
- Télévision : une seule chaîne, étatique, au service du pouvoir politique. Seule exception tolérée pour l’expression berbérophone : la chanson, de façon très parcimonieuse ;
- Radio nationale : 3 chaînes généralistes (arabe, français, kabyle) héritées de la période coloniale. Contrôle strict des contenus, contrôle de la qualité de la langue kabyle (censure des innovations lexicales) ;
- Cinéma : Production sous le contrôle de l’Etat. Seules langues utilisées : arabe et français, y compris lorsque l’action se déroule en région berbérophone (Kabylie, Aurès…).
Médias du côté de la revendication berbère : en Algérie
- Des bulletins culturels clandestins, à Alger, dans les années 1970 :
Itij (le soleil), en caractères tifinagh, animé par des militants proches de l’Académie berbère de Paris, dont plusieurs seront impliqués dans l’affaire des « poseurs de bombes » (1976) ;
Taftilt (la lampe), qui deviendra ensuite Itri (l’étoile). Bulletins à contenu culturel, en caractères latins, animés par des étudiants proches du cours de Mammeri ;
- Certaines émissions de sensibilisation (très discrète) de la radio kabyle d’Alger (radio d’Etat) ;
- Renouveau de la chanson kabyle, années 1970 ;
- Du théâtre en kabyle au début des années 1970, Alger, en milieu universitaire ;
- Le « Texte d’Alger », premier texte à avoir posé, notamment, la question berbère dans ses dimensions linguistique, culturelle et identitaire (1976) ;
- Mars 1980 : Inscriptions murales du FFS clandestin sur l’axe routier Alger – Tizi-Ouzou : slogans politiques hostiles au régime. Revendication de la démocratie ;
- Eté 1980 : le Dossier culturel de Yakouren. Publié et diffusé en Algérie d’abord, en France ensuite ;
- A partir du printemps berbère de 1980, très nombreux tracts, déclarations, etc. distribués à la population et publiés par la suite dans la revue Tafsut notamment et des revues de presse ;
- A partir de 1981 : la revue Tafsut (le printemps), publication emblématique du mouvement de revendication berbère. Les deux langues utilisées dans la revue sont le berbère (kabyle) et le français. Couverture en caractères néo-tifinagh, intérieur en caractères latins. Contenu politico- culturel : Informations diverses sur le mouvement de revendication berbère, publication de tracts, entretiens (y compris avec des opposants politiques), textes littéraires en berbère, etc. En plus de la série ordinaire (14 numéros), la revue Tafsut avait une série pédagogique et scientifique (3 numéros2) et une série spéciale3 Tafsut Etudes et débats (3 numéros). La revue Tafsut a été lancée à l’université de Tizi-Ouzou par un petit collectif composé d’enseignants et d’étudiants, mais elle sera très vite « externalisée » et prise en charge en dehors de l’université. Le tirage était fait clandestinement, aux domiciles de militants, sur du matériel de récupération de type graveur électronique et ronéo ;
—————————————————-
1 Auteurs : Mustapha Benkhemou, Amar Yahiaoui, Ammar Zentar, sous la direction de Mouloud Mammeri.
2 Tamusni tamezwarut di lebni (Abdenour Abdeslam) ; Tira n tmaziγt (Ramdane Achab) ; Lexique français-berbère de mathématiques (Hend Sadi, Mohamed Laïhem, Ramdane Achab).
3 Dirigée par Salem Chaker.
————————————————-
- Autres : Revue Tilelli, université de Tizi-Ouzou (quelques numéros) ; Médias du côté de la revendication berbère : en France
- Fin des années 1960 : Bulletin Imazighen (les Berbères) de l’Académie berbère, paraissant à Paris. Contenu culturel (sensibilisation à la langue, l’histoire et la civilisation berbères) et politique. Diffusion en France, en Algérie et au Maroc ;
- Bulletin d’Etudes Berbères (12 numéros, de 1973 à 1977), Groupe d’Etudes Berbères, Université Paris VIII-Vincennes. Suivi de la revue Tisuraf (7 numéros ordinaires et 5 numéros spéciaux) ;
- 1973 : articles de Mbarek Redjala dans Les temps modernes (n° 323) et L’homme et la société
(n°28), sur les problèmes linguistiques en Algérie, la spécificité culturelle et l’unité politique ;
- Quelques articles de presse (Libération) ;
- Théâtre Imesdurar, juin 1975, 1er Festival de Théâtre Populaire de l’Immigration, Suresnes ;
- Juin 1977 : une expérience de journal rédigé entièrement en berbère (kabyle) : Afud ixeddamen (la force des travailleurs), 1 seul numéro, précédé de quelques tracts en langue berbère dont certains sous le label du Parti communiste français, section du 14ème arrondissement de Paris ;
- Années 1980 : Très nombreux articles de presse concernant le printemps berbère de 1980. Une revue de presse en a été faite. Editée par la coopérative Imedyazen de Paris ;
- France et international : très bonne couverture médiatique des événements du printemps berbère ;
- France notamment : structures de soutien, comités, FFS, tracts, appels, rassemblements, meetings de soutien… ;
- 1985 : Revue Awal (la parole, le mot), créée à Paris par Mouloud Mammeri, Tassadit Yacine, avec le soutien de Pierre Bourdieu ;
- Revue Etudes et Documents Berbères, créée par Ouahmi Ould-Braham ;
- Partis et groupes politiques (FFS, PRS, groupes trotskystes algériens) : tracts, déclarations diverses, prises de position, Bulletin du Parti de la Révolution Socialiste qui prône en 1978 le passage à l’écrit pour la langue berbère. Journal Libre Algérie du FFS clandestin ;
- Télévision française : Hocine Aït-Ahmed revendique pour la langue berbère un statut de langue nationale en Algérie. La proposition est reprise dans l’avant-projet de plateforme politique du FFS (1979) intitulé « Pour une alternative démocratique révolutionnaire à la catastrophe nationale » ;
- Radios libres en France à partir de 1981.
5 b) Outils de la revendication après l’ « ouverture politique » de 1989
Dans le domaine de l’édition et des médias, la période qui suit l’ « ouverture politique » de 1989 est caractérisée par la fin des monopoles de l’Etat algérien, mais cela ne signifie ni la levée de tous les obstacles, ni même l’existence d’une volonté politique réelle de libéralisation. La libéralisation de l’édition et des médias est dans son ensemble à l’image de « l’ouverture politique » qui a été faite l’échelle du pays : un certain nombre de concessions certes, concrètes ou symboliques, mais le régime dispose toujours de leviers importants qu’il peut actionner dans le but de limiter, de détourner ou de neutraliser les effets de cette même libéralisation : la publicité pour les médias, les aides à l’édition, la distribution des livres dans les structures publiques comme les bibliothèques municipales, les volumineux marchés de l’édition scolaire, etc. L’allégeance politique et la corruption constituent les règles de base pour qui veut profiter des mannes de l’Etat.
L’édition
Une bonne dizaine d’éditeurs privés publient aujourd’hui des livres écrits en langue berbère, quelquefois dans des variétés linguistiques « appartenant » à d’autres pays (Maroc, Libye). A ces publications s’ajoutent celles du HCA dont les moyens, qui sont des moyens publics, sont beaucoup plus importants.
La libéralisation de l’édition reste cependant handicapée par le fait que des segments entiers ne sont que très difficilement accessibles à la distribution privée : bibliothèques scolaires, bibliothèques municipales, bibliothèques universitaires.
Les moyens matériels des éditeurs privés sont limités. L’édition du livre berbère, en plus d’être confrontée aux problèmes de l’édition en général (lectorat, distribution, faiblesse de la critique littéraire, etc.) connaît des problèmes spécifiques dus à sa nouveauté et au statut social de la langue, ainsi que des problèmes plus techniques relevant de l’aménagement linguistique (graphie, orthographe, terminologie, etc.)
Certains auteurs préfèrent recourir à l’édition à compte d’auteur, d’autres à l’édition numérique (sur internet). De nombreux auteurs n’arrivent pas à faire publier leurs œuvres.
Médias
On peut parler d’une libéralisation relative du champ médiatique. Relative parce que les journaux, les chaînes de télévision (étatiques ou privées) et les radios restent tributaires des puissances d’argent (l’État en est une), des organisations politiques et des clans.
La langue berbère est présente, sous plusieurs variétés, dans ces médias : presse écrite, chaînes nationales et chaînes privées de télévision, radio nationale et radios régionales (Tizi-Ouzou et Bgayet) qui appartiennent à l’État, les radios libres en France notamment. Mais il faut préciser que la place de la langue berbère dans la presse écrite est aujourd’hui proche de l’insignifiance, après avoir connu, au tout début des années 1990, deux organes partisans (Asalu du RCD et Amaynut du FFS) qui lui étaient entièrement dédiés.
A cette situation peu reluisante sur le plan quantitatif pourraient s’ajouter des considérations sur la qualité de la langue utilisée dans ces médias : manque d’expressivité, souvent manque de maîtrise de la langue, abus de néologismes, calques à partir du français et de l’arabe, alternance de code linguistique ou code-switching, probablement encouragé à la radio et à la télévision pour favoriser l’étiolement de la langue et accélérer son extinction. Enfin, certaines émissions télé et certains films semblent destinés à renforcer la haine de soi en donnant une image dégradante de la société berbère.
Signalons l’existence de quelques revues ou bulletins associatifs qui accordent une certaine place, voire toute la place, à la langue berbère. Aussi la présence de la langue sur internet de façon générale et les réseaux sociaux en particulier.
Signalons aussi les représentations théâtrales, les festivals de poésie, de cinéma amazigh (berbère), les cafés littéraires, les conférences-débats qui sont autant de situations où la langue est utilisée et valorisée.
Ramdane Achab éditeur, enseignant