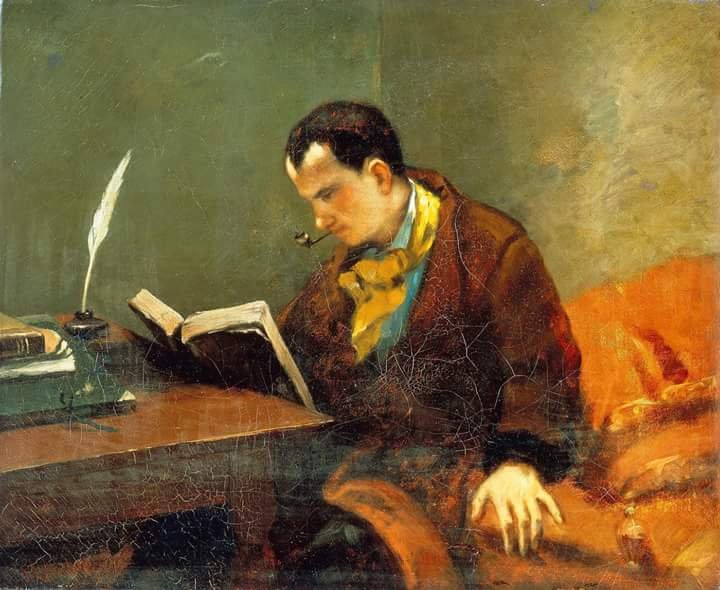ALGER – Les cinq groupes parlementaires représentant la majorité ont réitéré, mardi à Alger, le maintien de leur revendication de démission du président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Said Bouhadja, refusant toute médiation en ce sens.
Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion des présidents des cinq groupes parlementaires, le président du groupe parlementaire du FLN, Mouaad Bouchareb, a réitéré l’attachement de ces groupes à la revendication de démission du président de la chambre basse, Said Bouhadja, ajoutant « nous sommes déterminés à travailler de concert jusqu’à l’aboutissement de notre objectif, à savoir la démission, dans les jours à venir, du président de l’Assemblée ».
Le représentant des groupes parlementaires de partis de la majorité a démenti les informations faisant état d’un volte face de certains députés, affirmant que « tous les députés restent engagés par les décisions des groupes et aucun n’est allé à contre-courant ».
Par ailleurs, M. Mouad a exprimé, au non des groupes parlementaires de la majorité, « le rejet de toute médiation » avec le président de l’APN, qualifiant de « mort-nées » les initiatives émanant de certains partis.
En réponse à une question sur l’accusation des groupes parlementaires de +comploter+ contre le président de l’APN, il a déclaré « il n’est pas de nos principes de comploter contre les Hommes de l’Etat Pour rappel, les présidents des groupes parlementaires des partis du Front de Libération nationale (FLN), du Rassemblement national démocratique (RND), de Tajamoue Amel El Djazair (TAJ), du Mouvement populaire algérien (MPA) et des Indépendants avait remis il y’a 10 jours, au président de l’APN, une motion de retrait de confiance exigeant sa démission avant le gel de toutes les activités des structures de l’APN jusqu’à satisfaction de leur revendication.
Les députés avaient dénoncé des « dépassements et violations » enregistrés au sein de l’institution législative, à savoir « marginalisation éhontée, l’ajournement prémédité de l’adoption du Règlement intérieur de l’APN, marginalisation des membres de la Commission des affaires juridiques, mauvaise gestion, frais exagérées déboursées illicitement, la non répartition des missions à l’etranger sur la base de la représentation proportionnelle et recrutement aléatoire et douteux ».
Source , APS.