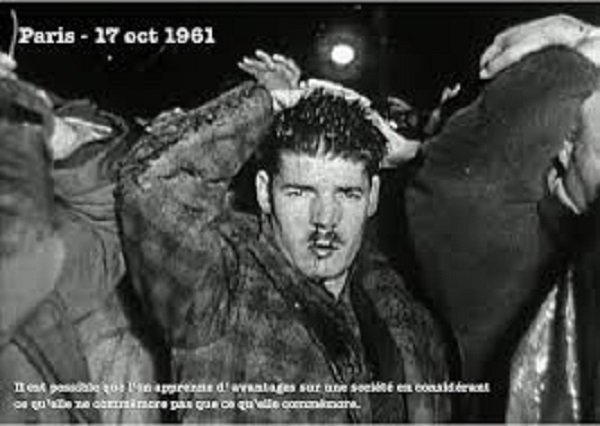France : C’est en urgence que le ministre de l’Éducation a joué, jeudi, les pompiers de la laïcité. Deux jours auparavant, une note des renseignements généraux, dévoilée par Europe 1, avait mis le feu aux poudres, l’article mentionnant d’inquiétantes atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires. De leur côté, tient à faire savoir Jean-Michel Blanquer, les services académiques dédiés à cette problématique ont traité 404 cas graves, pour la plupart liés à la religion musulmane. Refus de manger de la nourriture non halal ou d’aller à la piscine, rejet de certains enseignements liés à la littérature des Lumières ou au darwinisme, paroles inappropriées lors de commémorations, refus pour un enfant de donner la main à une fille et pour un parent de serrer la main à une enseignante… Autant de situations que le ministre ne veut « ni dramatiser, ni minimiser », a-t-il dit.
« La liberté de conscience, c’est vivre sans subir aucune des croyances d’autrui », a-t-il martelé jeudi lors de l’ouverture du séminaire national des « coordonnateurs des équipes laïcité et fait religieux », dont il était l’invité surprise. La veille, les journalistes avaient tardivement été conviés à cette séquence communication. Objectif : démontrer que tout est sous contrôle, et que le ministre, suivant une expression qu’il affectionne, « ne met pas la poussière sous le tapis ». « C’est la fin de la naïveté. J’espère qu’elle est actée pour tous », a-t-il lancé dans son discours d’ouverture du séminaire, qui réunissait une cinquantaine de référents autour du sujet laïc, de l’antisémitisme au sexisme en passant par l’homophobie et l’organisation du culte musulman en France.
Pour appuyer son propos, les chiffres des signalements : entre avril et juin 2018, un millier de faits d’atteintes au principe de laïcité ont été signalés par les équipes académiques « laïcité et fait religieux », ainsi que par les personnels de l’Éducation nationale via la plateforme mail d’alerte mise en place en mai par le ministère. Entre les situations réglées au niveau de l’établissement et celles relevant finalement davantage du climat scolaire ou de cas de harcèlement, 404 faits graves ont été traités par les équipes académiques dédiées, dont 60 ont fait l’objet d’une intervention sur le terrain. Plus de 70 % de ces faits se concentrent sur dix académies. Ils concernent avant tout les collèges (44 %), suivis des écoles primaires (36 %) et des lycées (20 %). « Les cas augmentent davantage dans le premier degré », a relevé le ministre, preuve que l’environnement familial et les habitudes culturelles jouent un rôle déterminant. Si ces faits de contestation des valeurs laïques émanent majoritairement des élèves (à 57 %), ils viennent aussi des parents (24 %) et des personnels de l’Éducation nationale (8 %).
Ces signalements augmentent-ils ? Le ministère ne saurait le dire, expliquant qu’une nouvelle méthodologie dans la remontée des incidents a été mise en place en mai. Impossible, poursuit-il, de faire une comparaison avec le dispositif mis en place par Najat Vallaud-Belkacem, sous le quinquennat Hollande, dans la foulée des attentats. En mai 2015, devant la commission des affaires culturelles du Sénat, la ministre avait fait état de 816 signalements en neuf mois.
Radicalisation des pratiques
De l’avis du ministère et des professeurs sur le terrain, le nombre des atteintes à la laïcité n’explose pas. En revanche, certains cas révèlent une radicalisation des pratiques. « La couleur rouge, je n’avais jamais vu cela », a observé le ministre au sujet de ces élèves, mentionnés dans la note des renseignements généraux, refusant d’avoir cours dans une classe comportant du mobilier rouge, jugé haram, autrement dit interdit par le Coran. Face à cette «inventivité de contestation», le ministre entend opposer « l’esprit de logique » et « l’esprit de concorde civile ». À l’expression rebattue de « vivre ensemble », Jean-Michel Blanquer explique préférer celle de « bien vivre ensemble ». « Ce qui suppose une capacité à écouter et comprendre », ajoute-t-il.
CAROLINE BEYER
Source : LE FIGARO