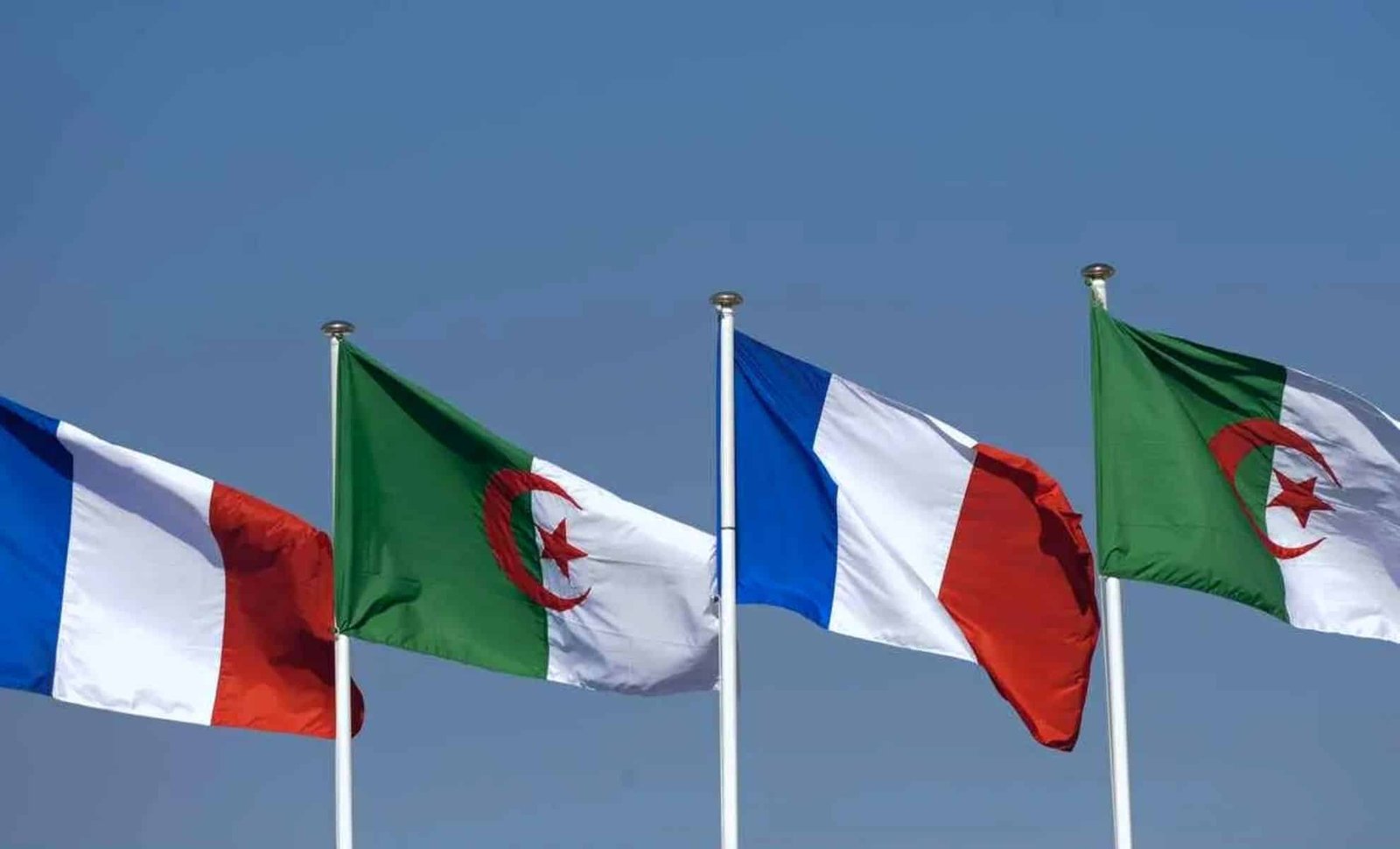La France a quitté l’Algérie en 1962. Enfin, officiellement. Mais n’ayons pas la naïveté de croire qu’elle a laissé tout derrière elle, y compris la gestion de son empire. Si le drapeau tricolore a quitté Alger, une autre forme de pouvoir colonial a trouvé refuge bien plus près de nous : dans les bureaux feutrés du ministère de l’Intérieur.
Car la France n’a pas vraiment quitté l’Algérie. Elle a simplement transféré l’affaire au 14 rue de la Préfecture.
Si, en 1962, la décolonisation fut un acte politique, la récolonisation des esprits et des territoires a pris une autre forme : plus subtile, mais tout aussi violente. Le ministère de l’Intérieur, héritier de l’ordre colonial, a continué, sans interruption, d’asseoir sa souveraineté. Sauf que maintenant, cette souveraineté s’exerce non plus au sein de colonies lointaines, mais à l’intérieur même des frontières de la République.
Que reste-t-il du colonialisme ? À première vue, rien. La France a renoncé à ses possessions en Afrique du Nord, mais elle n’a jamais renoncé à sa manière de contrôler, de surveiller, de juger. Parce qu’une souveraineté n’est pas simplement territoriale, elle est culturelle et politique. Elle se maintient dans les mots, les gestes, les lois. L’Intérieur, autrefois bras armé du colonialisme, est devenu le rempart contre l’“autre”, contre la différence.
Prenons l’exemple de la guerre d’Algérie (1954-1962). Si la France a officiellement mis fin à la colonisation en 1962, elle n’a jamais mis fin à la manière dont elle percevait et contrôlait les populations d’origines algériennes sur son sol. Le ministère de l’Intérieur a, dès lors, joué un rôle central dans cette gestion postcoloniale, en maintenant une surveillance systématique des Algériens, qu’ils soient en métropole ou en Algérie. Les accords d’Évian, censés ouvrir la voie à une indépendance, n’ont pas effacé les cicatrices de la guerre. Au contraire, ils ont permis de maintenir un ordre sécuritaire, particulièrement visible lors des répressions violentes des manifestations en France, comme celle du 17 octobre 1961, où la police parisienne a tué des dizaines de manifestants algériens dans le silence des autorités. Un épisode sinistre qui ne fait que souligner cette contamination du ministère de l’Intérieur par les logiques de la guerre d’Algérie.
La politique de répression n’a pas cessé après 1962. En 1983, la Marche des Beurs, initiée par des jeunes d’origine maghrébine, réclamait une meilleure intégration et la fin de la discrimination. Mais cette marche a été largement ignorée par les autorités. Pourtant, la question de l’immigration, déjà lancinante, n’a cessé de nourrir les discours sur l’identité nationale. Depuis les années 1980, le ministère de l’Intérieur est le premier à dicter la politique de contrôle migratoire, avec une gestion autoritaire des frontières et des quotas. Mais plus encore, il a, à plusieurs reprises, utilisé la question des immigrés pour justifier une répression policière massive, notamment à travers les lois anti-immigration comme la loi Pasqua de 1993, qui a renforcé les contrôles et facilité l’expulsion des étrangers en situation irrégulière.
Les émeutes de 2005 en banlieue parisienne, déclenchées par la mort de deux adolescents, Zyed et Bouna, dans un quartier populaire de Clichy-sous-Bois, ont mis en lumière l’échec du modèle républicain. La réaction de l’État ? L’instauration de l’état d’urgence, une réponse sécuritaire et répressive, qui est venue rappeler que, dans certains quartiers, la France réprime avant même de tenter d’intégrer.
La même logique s’est retrouvée dans les réformes du contrôle de l’immigration sous la présidence de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur. En 2007, il fait de la lutte contre l’immigration illégale un cheval de bataille, avec des expulsions massives et une politique de régularisation strictement encadrée. Sarkozy a été clair : “Il n’y a pas de place pour l’immigration illégale dans la République”. Mais il oubliait de mentionner que, souvent, les racines de cette immigration étaient les mêmes que celles de la colonisation, les liens historiques entre les anciennes colonies et la métropole.
La république sous surveillance
L’obsession du contrôle est également visible dans la gestion de l’Islam en France, avec des lois comme la loi sur le voile intégral de 2010 et la loi sur les séparatismes de 2021. Dans les deux cas, la menace de l’“autre” a justifié un renforcement de la surveillance et des restrictions sur les libertés individuelles. Il ne s’agissait plus de combattre des résistances coloniales ou des révoltes politiques, mais des « identités étrangères », perçues comme incompatibles avec la république laïque. Là encore, le ministère de l’Intérieur joue un rôle clé : l’assignation à résidence des populations par leur origine, par leur culture, par leur religion.
Aujourd’hui, la France parle de la décolonisation comme d’un événement passé, un épiphénomène. Mais l’Intérieur montre que l’impératif colonial n’a jamais été complètement évacué. Il a été, plutôt, réincarné dans la gestion de ses héritages, sous forme de politiques de contrôle et de surveillance, dans les lois et dans les pratiques policières.
La France a quitté l’Algérie, mais le ministère de l’Intérieur n’a jamais cessé de la garder sous clé. Il ne s’agit plus de coloniser des terres, mais d’assujettir des populations sous prétexte de maintenir l’ordre républicain. Le miroir est devenu plus complexe, plus intérieur, mais l’illusion de pouvoir est restée. Il y a encore une république à contrôler, et il y a encore des indigènes à gérer.
Et tant que cette logique persistera, la France continuera de jouer à « Je t’aime, moi non plus » avec son propre passé colonial. « La colonisation n’a jamais été un événement passé, elle est simplement entrée dans une autre phase, celle où les frontières sont invisibles mais tout aussi puissantes. » Frantz Fanon.
Dr A. Boumezrag