Dans un nouveau chapitre de l’ouvrage “ »Dissidence populaire Regards croisés », le juriste Massensen Cherbi analyse les fondements juridiques ayant permis la répression du Hirak depuis 2021. Il souligne la révision constitutionnelle de 2020 renforçant les pouvoirs de l’armée et la législation liberticide utilisée pour restreindre les libertés et démobiliser ce soulèvement populaire durable.
mai-juin 2021, le Hirak ne connaît plus d’expression publique en Algérie. Les marches monumentales du vendredi, qui s’étaient propagées sur l’ensemble du pays, à partir du 22 février 2019, sont désormais interdites, après la publication, le 20 mai 2021, d’un communiqué rappelant la nécessité d’une autorisation préalable pour pouvoir manifester. En outre, l’ordonnance n° 21-08 du 8 juin 2021, en criminalisant les revendications du Hirak par une extension de la qualification de terrorisme (C. pén., art. 87 bis, 14), a permis de mettre un terme au Mouvement, pour ne plus laisser subsister depuis qu’un « Hirak des catacombes ».
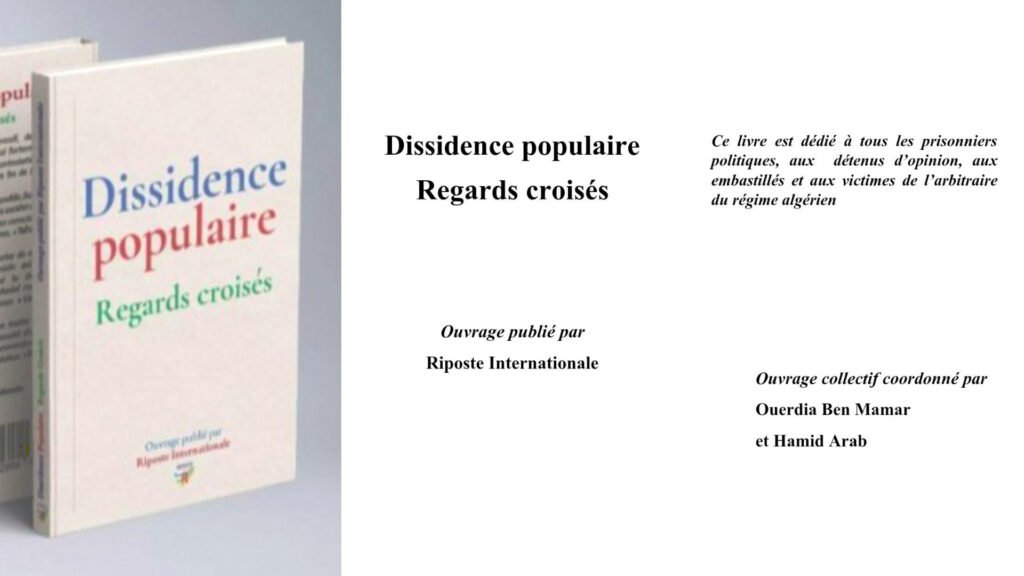
La répression commença dès le mois de juin 2019, alors que le chef d’État-major, le général Ahmed Gaïd Salah, tentait d’imposer une élection présidentielle rejetée par la rue. Dans un communiqué du 18 juin, il dénonça le risque d’un « vide constitutionnel », en s’opposant à toute transition démocratique hors de la Constitution autoritaire, avant d’ouvrir la voie à la répression du Mouvement, le lendemain 19 juin, en stigmatisant les porteurs de l’emblème amazigh, prétexte qui servit plus généralement à une répression de l’ensemble du Mouvement.
Pour ce faire, les autorités bénéficiaient d’une législation liberticide, héritée de l’époque du parti unique, à travers l’« entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale » (C. pén., art. 75), l’« atteinte à l’intégrité de l’unité nationale» (C. pén., art. 79) ou encore l’« atteinte à l’intérêt national » (C. pén. art. 96), incriminations issues du Code pénal de 1966, tel qu’amendé en 1975; mais aussi de dispositions issues de la Décennie noire, à travers la loi n° 91-19 du 2 décembre 1991, limitant la liberté de manifestation, tandis que le décret-législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 avait introduit en droit algérien l’incrimination de terrorisme. Plus tard, afin de prévenir la contagion des Printemps arabes de 2011, la loi n° 12-06 du 12 janvier 2012 vint limiter la liberté d’association.
Cette législation répressive fut par ailleurs adaptée, pour répondre aux spécificités induites par le Hirak, à travers la promulgation de nouvelles dispositions répressives, par les lois n° 20-0523 et 20-0624, dès le 28 avril 2020, soit en contexte de de confinement, et in fine par l’ordonnance susmentionnée n° 21-08 du 8 juin 2021, alors que le Hirak venait de reprendre ses marches.
Entre-temps, la révision constitutionnelle du 30 décembre 2020, issue d’une initiative présidentielle et non d’une Assemblée constituante, avait permis de légitimer l’intervention contra-constitutionem du chef d’État-major dans la vie politique du pays en 2019, en proclamant désormais que l’armée a pour mission de préserver « les intérêts vitaux et stratégiques du pays » (art. 30, al. 4), tandis que sur le plan des droits et libertés constitutionnels, elle proclame dorénavant qu’il est possible d’y déroger par une loi, afin de préserver l’ordre public, la sécurité et les constantes nationales (art. 34, al. 2). Dès lors, dans quelle mesure ces dispositions, tant constitutionnelles que législatives, ont-elles permis d’étouffer toute expression publique du Hirak ?
Pour ce faire, il conviendra d’étudier comment la révision constitutionnelle de 2020 a permis de répondre aux blocages institutionnels de l’année 2019 et aux problèmes juridiques posés par la répression du Hirak (I), avant d’apprécier comment celle-ci s’est fondée sur une législation préexistante au Mouvement et sur une législation spécialement promulguée dans ce cadre, afin de mieux y mettre un terme (II).
Une révision constitutionnelle autoritaire, afin de répondre aux blocages institutionnels de l’année 2019 et aux problèmes juridiques posés par la répression du Hirak.
Afin de répondre aux blocages institutionnels de l’année 2019, la révision constitutionnelle de 2020 fait désormais de l’armée la garante des « intérêts vitaux et stratégiques du pays » (A), tout en prévenant les effets de l’exception d’inconstitutionnalité à l’égard de la législation répressive (B).
Une armée proclamée garante des « intérêts vitaux et stratégiques du pays »
Le principal changement induit pas la révision constitutionnelle de 2020 est la redéfinition des missions de l’armée. Celle-ci est en effet désormais proclamée garante des « intérêts vitaux et stratégiques du pays conformément aux dispositions constitutionnelles » (art. 30, al. 4). Cette disposition ne figurait pas initialement dans l’avant-projet de mai 2020 mais a été introduite dans le projet de septembre suivant, à la suite d’une proposition émanant du ministère de la Défense nationale (la n° 1317).
Cette nouvelle disposition tranche avec la dépolitisation constitutionnelle que l’armée avait connue, à partir de la Constitution de 1989, lorsqu’elle avait perdu son rôle de « bouclier de la Révolution » que lui avait confié la Constitution de 1976 (art. 82, al. 1er). Sa repolitisation, consécutive à la montée du Front islamique du salut (FIS) et à l’arrêt du processus électoral de janvier 1992, avait déjà donné lieu, en 1993 et 1996, à deux propositions émanant de comités d’experts, afin d’en faire un gardien de la Constitution, sans néanmoins être retenues dans la version finale de la Constitution de 1996. C’est donc dans la crise institutionnelle de l’année 2019 que doit être recherchée l’origine d’une telle disposition. En effet, alors que la rue algérienne avait rassemblé jusqu’à 13 millions de marcheurs, le 8 mars 2019, il n’existait aucun contre-pouvoir constitutionnel à même d’arrêter l’hubris du président Bouteflika et lorsque l’armée intervint pour le pousser à la démission, à partir du 26 mars 2019, c’est sans aucun fondement juridique.
C’est désormais chose faite, en ce que ces « intérêts vitaux et stratégiques du pays » constituent une ligne rouge indéfinie à l’égard du président et du Parlement. En effet, que sont ces « intérêts vitaux et stratégiques »? Ils peuvent aussi bien renvoyer aux affaires militaires qu’aux affaires étrangères, à la politique nationale, aux questions économiques, cultuelles ou culturelles. Certes, l’alinéa 4 précise « conformément aux dispositions constitutionnelles », sans néanmoins préciser desquelles il s’agit. Or, si le président est bien proclamé par la Constitution «Chef suprême des Forces Armées » (art. 91, al. 1er, 1), qu’adviendrait-il s’il venait à enfreindre telle autre disposition constitutionnelle que l’armée considérait comme relevant des « intérêts vitaux et stratégiques » ? Quelle disposition faudrait-il alors faire prévaloir : le rapport hiérarchique ou bien les «intérêts vitaux et stratégiques » ?
Dans cette dernière hypothèse, confortée par les propositions des années 1990 et les blocages institutionnels de l’année 2019, l’armée devient un nouveau gardien de la Constitution, suivant en cela la révision constitutionnelle égyptienne de 2019 (art. 200, al. 1er). Ce faisant, le de facto de l’année 2019, voire des années 1990, devient désormais de jure et l’ultra- présidentialisme, encore largement hérité de la Constitution du colonel Boumediene, se trouve désormais modéré par la constitutionnalisation du pouvoir d’arbitrage de l’armée. Une telle disposition apparaît dès lors manifestement incompatible avec la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007, pourtant ratifiée par l’Algérie, lorsque celle-ci prévoit que « les États parties renforcent et institutionnalisent le contrôle du pouvoir civil constitutionnel sur les forces armées et de sécurité aux fins de la consolidation de la démocratie et de l’ordre constitutionnel » (art. 14, § 1). Elle constitue par ailleurs une fin de non-recevoir à l’une des revendications majeures du Hirak : celle d’un « État civil, non militaire ».
Des droits et libertés limités au vague respect de l’ordre public, de la sécurité et des constantes nationales
Autre disposition majeure, la révision constitutionnelle prévoit désormais qu’il est possible de déroger aux « droits, libertés et garanties », par une loi, « pour des motifs liés au maintien de l’ordre public, de la sécurité et de la protection des constantes nationales » (art. 34, al. 2), et ce sans prévoir les garde-fous de la nécessité et de la proportionnalité dans une société démocratique. Tout au plus, la révision prévoit que ces dérogations législatives ne peuvent « porter atteinte à l’essence de ces droits et libertés » (art. 34, al. 3). L’article 34, alinéa 2 permet ainsi de prévenir les effets de l’exception d’inconstitutionnalité, introduite par la révision constitutionnelle de 2016 et entrée en vigueur le 7 mars 2019, en constitutionnalisant la législation répressive appliquée à l’encontre du Hirak. Que sont d’ailleurs les constantes nationales ? Aucune disposition constitutionnelle ne les dénombre ni ne les définit, ce qui laisse ainsi une large marge de manœuvre, tant aux juges qu’aux membres de la Cour constitutionnelle, non sans rappeler les dérogations aux droits et libertés, dans les Constitutions de 1963 et 1976, en cas d’usage contre le parti unique ou la Révolution socialiste (respectivement, art. 22 et 73).
De là, une libéralisation apparente pour certains droits et libertés. D’ailleurs, au-delà du nouvel article 34, différents subterfuges constitutionnels permettent d’en écarter l’application. La révision prévoit ainsi que « les lois, dont la modification ou l’abrogation sont rendues nécessaires en vertu de la présente Constitution, demeurent en vigueur jusqu’à l’élaboration de nouvelles lois ou leur modification dans un délai raisonnable» (art. 225). Or, quel est ce délai raisonnable ? En effet, les lois organiques relatives à la Haute Cour de l’État ou à l’état de siège et l’état d’urgence, prévues par la Constitution de 1996, n’ont toujours pas été promulguées après plus d’un quart de siècle.
Si la révision reconnaît désormais le droit de créer des associations et de manifester « sur simple déclaration » (respectivement, art. 53, al. 1er et 52, al. 2), au lieu du régime d’autorisation préalable qui prévalait jusque-là, c’est non seulement dans la mesure de l’article 34, al. 2, mais aussi du « délai raisonnable » susmentionné. En outre, qu’il s’agisse de la liberté d’association ou du multipartisme, la Constitution reconnaît le droit de « créer » des associations et des partis politiques (respectivement, art. 53, al. 1er et 57, al. 1er), et non le droit d’exercer ces droits. Dès lors, si elle facilite leur création, la Loi fondamentale permet de maintenir les dispositions législatives exorbitantes qui en limitent le libre exercice, en facilitant la suspension de leurs activités, voire leur dissolution.
En outre, au-delà de toute libéralisation apparente, la liberté de conscience, en réalité de croyance dans le texte arabe, notion plus étroite, a été supprimée de la Constitution. Si « la liberté d’exercice des cultes » (art. 51, al. 2), désormais proclamée au pluriel, est maintenue, c’est toujours dans le cadre du vague « respect de la loi » (art. 51, al. 2) et désormais des constantes nationales (art. 34, al. 2).
Une répression fondée sur une législation préexistante, héritée de l’ère du parti unique, de la Décennie noire et des Printemps arabes, adaptée aux spécificités du Hirak
Pour étouffer et mettre un terme au Hirak, les autorités puisèrent dans une législation préexistante qu’ils raffermirent afin de restreindre à la fois les libertés collectives (A) et les libertés individuelles (B).
Une législation restrictive des libertés de manifestation, d’association et du multipartisme
Aucune des marches du vendredi n’était autorisée. Elles étaient tout au plus tolérées, notamment en raison des millions de manifestants des premiers mois du Hirak. En effet, depuis la grève insurrectionnelle du FIS, de mai-juin 1991, la loi n° 91-19 du 2 décembre 199134 a fait passer le droit de manifestation d’un régime déclaratif à un régime d’autorisation préalable (art. 15, al. 2). C’est ainsi qu’en l’absence d’autorisation des autorités, une fois la répression engagée à partir du mois de juin 2019, les marches hors du vendredi, voire du mardi des étudiants, furent réprimées pour participation à attroupement non armé (C. pén., art. 98) ou pour incitation directe à attroupement non armé (C. pén., art. 100).
Pour retenir cette dernière infraction, les juges considérèrent, dans l’affaire Nacer Meghnine, que le seul fait de distribuer des tracts reproduisant des photos de détenus d’opinion constituait une incitation à sortir et à se rassembler, tandis que dans l’affaire Fethi Ghares, ils caractérisèrent un tel délit du fait d’avoir appelé à continuer le Hirak sur les réseaux sociaux. In fine, les autorités publièrent, le 20 mai 2021, un communiqué rappelant la nécessité d’une autorisation préalable, y compris pour les marches du vendredi, depuis quoi la capitale et l’ensemble du pays ne connaissent plus de marches.
Quant à la liberté d’association, elle avait déjà été restreinte, à l’occasion de la loi n° 12-06 du 12 janvier 2012, promulguée dans un contexte de prévention des Printemps arabes, notamment par la mise en place d’un régime d’autorisation préalable qui avait conduit à la disparition de la moitié des associations. C’est d’ailleurs sur le fondement de l’article 23 de la loi n° 12-06 que l’association Rassemblement Action Jeunesse (RAJ), particulièrement active en contexte de Hirak, fut dissoute par le tribunal administratif d’Alger, pour avoir reçu à son siège des militants tunisiens des droits humains, sans l’autorisation préalable des autorités compétentes. Plusieurs militants associatifs furent par ailleurs emprisonnés, du président de l’association SOS Bab el-Oued, Nacer Meghnine au président de l’association RAJ, Abdelouahab Fersaoui42.
Le multipartisme n’a pas non plus servi de caisse de résonnance aux revendications du Hirak. En effet, nonobstant la question de la représentation du Mouvement, il avait été considérablement restreint, sur un plan légal, à la suite de l’arrêt du processus électoral, en janvier 1992, par l’ordonnance n° 97-09 du 6 mars 1997, telle qu’amendée par la loi organique n° 12-04 du 12 janvier 2012. C’est d’ailleurs pour ne pas avoir respecté la loi organique n° 12-04, que les activités du Parti socialiste des travailleurs (PST) furent suspendues. Ce sont plus généralement les partis opposés aux élections organisées depuis 2019 qui furent inquiétés. Le RCD a ainsi reçu une mise en demeure, le 5 janvier 2022, à la suite de l’organisation, le 24 décembre précédent, d’un Front contre la répression dans ses locaux, tandis que les dirigeants du l’Union démocratique et sociale (UDS), Karim Tabbou ; du Mouvement pour la jeunesse et le changement (MJC), Rachid Nekkaz; et du Mouvement démocratique et social (MDS), Fethi Ghares, furent condamnés à de la prison ferme.
Une législation restrictive des libertés d’expression et de la presse
Sur le plan des libertés individuelles, c’est l’emblème amazigh qui servit de prétexte à la répression du Hirak. Pour ce faire, c’est l’atteinte à l’intégrité de l’unité nationale (C. pén., art. 79) qui servit de fondement aux poursuites. Or, comment déterminer les éléments constitutifs de cette unité nationale ? Pour entrer en condamnation, le tribunal de Sidi M’hamed se fonda, dans un jugement du 11 novembre 2019, sur la constitutionnalisation du drapeau algérien, lors de la révision constitutionnelle de 2008 (2016/2020, art. 6), pour considérer qu’il s’agissait d’un emblème unique et que dès lors, le port d’un autre drapeau portait atteinte à l’unité nationale. Le tribunal d’Annaba avait cependant rejeté une telle interprétation, dès le 8 août précédent, en se fondant notamment sur la reconnaissance constitutionnelle de l’amazighité, dans le préambule constitutionnel, depuis 1996 (§ 4). In fine, une fois le chef d’État-major décédé, la cour d’Alger finit par relaxer des prévenus, le 18 mars 2020, en se fondant cette fois-ci sur la constitutionnalisation du tamazight, c’est-à-dire de la langue berbère (2016 et 2020, art. 4).
L’atteinte à l’intégrité de l’unité nationale servit cependant plus largement de fondement à la répression de l’ensemble du Mouvement. L’opposant politique Karim Tabbou fut ainsi condamné par la cour d’Alger, le 24 mars 2020, à un an de prison ferme, pour avoir distingué entre les hauts gradés nantis de l’armée et les simples soldats désœuvrés, ce en quoi les juges considérèrent qu’il avait cherché à diviser l’armée. Quant au journaliste Khaled Drareni, il fut condamné du même chef, par la même cour, le 15 septembre 2020, à deux ans de prison ferme, pour avoir critiqué la légitimité du président de la République, alors que la Constitution proclame qu’il « incarne l’unité de la Nation » (2016 et 2020, art. 84, al. 1er).
L’atteinte à l’intérêt national fut elle aussi mobilisée (C. pén., art. 96) et appliquée à l’encontre de Nacer Meghnine, en raison de pancartes retrouvées au siège de son association, dénonçant les arrestations arbitraires, la répression et la torture, ce en quoi les juges considérèrent que le prévenu ne pouvait pas prouver ces dires qui nuisaient à l’image de l’Algérie, tout en incitant à l’ingérence étrangère. Quant au commandant Lakhdar Bouregaâ, ancien combattant de la guerre de libération nationale, il fut condamné le 7 mai 2020, par le tribunal de Bir Mourad Raïs, à 100 000 dinars d’amende pour outrage à corps constitué (C. pén., art. 144 bis et 146), notamment pour avoir affirmé que l’Armée nationale populaire (ANP) n’était pas l’héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), ce pourquoi il avait passé six mois en détention provisoire, à près de 86 ans.
La liberté de la presse fut particulièrement attaquée. Pour contourner la disposition constitutionnelle qui prohibe la privation de liberté pour délit de presse (2016, art. 50, al. 4 ; 2020, art. 54, al. 5), les juges usèrent de deux types de subterfuges. Dans l’affaire Khaled Drareni, ils rappelèrent que pour bénéficier de la protection susmentionnée, la Constitution renvoie à la loi (2016, art. 50, al. 3 ; 2020, art. 54, al. 2, tiret 6) et que la loi organique n° 12-05 du 12 janvier 2012 nécessite pour se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnel une carte de presse (art. 76) et un contrat écrit (art. 80), ce dont le prévenu ne pouvait se prévaloir. Quant à l’affaire Rabah Karèche, la qualité de journaliste ne fut pas déniée au prévenu, mais pour le condamner, le juge de Tamanrasset distingua entre ses articles parus dans la presse, en sa qualité de journaliste, et pour lesquels il ne pouvait être emprisonné, du partage de ces mêmes articles sur ses propres réseaux sociaux, en sa qualité de personne privée, c’est-à-dire insusceptible d’une telle protection.
La législation pénale fut par ailleurs amendée afin de s’adapter aux spécificités induites par le Hirak. Promulguées en pleine période de pandémie, les lois n° 20-05 et 20-06 du 28 avril 2020 ont introduit à la fois la répression des discours de haine, du « délit de solidarité » (C. pénal., art. 95 bis) et du délit de diffusion de « fake news » (C. pén., art. 196 bis). Quant à l’ordonnance n° 21-08 du 8 juin 2021, elle constitue le sommet de la répression, en ce qu’elle qualifie désormais de terroriste toute action ayant pour objet d’«accéder au pouvoir ou […] changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels » (C. pén., art. 87 bis, 14).
Ce faisant, elle permet de criminaliser la revendication d’une transition démocratique hors de la Constitution autoritaire, portée à partir du mois d’avril 2019 par le Hirak. Ce « terrorisme pacifique », qui ne nécessite pas d’acte de violence, en portant ainsi gravement atteinte à la liberté d’expression, a surtout été employé à l’encontre des militants et sympathisants, réels ou amalgamés, du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK) et de Rachad (islam politique), organisations survalorisées par les autorités afin de décrédibiliser le Hirak.
Une mobilisation réussie du droit pour mieux démobiliser le Hirak
À quatre ans du 22 février 2019, la législation et la jurisprudence étudiées ont permis d’incriminer la revendication d’une transition démocratique, hors de la Constitution autoritaire, sur le fondement du terrorisme (C. pén., art. 87 bis, 14) ; l’appel à continuer le Hirak, sur le fondement de l’incitation directe à attroupement non armé (C. pén., art. 100); marcher le vendredi, sur le fondement de l’attroupement non armé (C. pén., art. 98) ; tandis que s’opposer aux élections et plus généralement au régime en place peut conduire à la suspension, voire la dissolution, d’une association ou d’un parti politique. Quant à la dénonciation de la torture, elle est passible d’atteinte à l’intérêt national (C. pén., art. 96), tandis que l’appel à la grève générale est passible d’atteinte à l’intégrité de l’unité nationale (C. pén., art. 79), tout comme le fait de critiquer la légitimité du président de la République ou la place de l’armée.
Par ailleurs, pour répondre aux revendications du Hirak, en faveur d’un changement radical de système par la consécration de la souveraineté populaire et de son corolaire, l’État civil non militaire, les autorités procédèrent à une révision constitutionnelle autoritaire, d’initiative présidentielle, qui est venue renforcer l’état de fait de l’année 2019 au bénéfice de l’armée, en la proclamant désormais garante des « intérêts vitaux et stratégiques du pays » (art. 30, al. 4), tandis que la législation répressive et restrictive des droits et libertés s’est vue confortée, par la possibilité de déroger aux droits et libertés constitutionnels par une loi, afin de préserver l’ordre public, la sécurité et les constantes nationales (art. 34, al. 2).
C’est ainsi que les espaces publics à même de permettre la libre expression du Hirak, qu’il s’agisse de la presse, des marches du vendredi ou des réseaux sociaux, ont été considérablement restreints. Encore récemment, en décembre 2022, l’un des derniers médias d’opposition, Radio M, était fermé par les autorités, tandis qu’en début janvier 2023, Rachid Nekkaz, plusieurs fois condamné à de la prison ferme, annonçait son retrait de la vie politique. Depuis les mois de mai et juin 2021, le Hirak a donc perdu pratiquement toute expression publique en Algérie et ne peut plus y subsister que dans le silence du boycott passif des élections organisées par les autorités.
Massensen Cherbi
Docteur en droit Université Paris II Panthéon-Assas


