Dans l’ouvrage collectif intitulé “Dissidence populaire Regards croisés” publié par l’ONG Riposte Internationale et coordonné par Ouerdia Ben Mamar et Hamid Arab, l’une des contributions est signée par Lahouari Addi, professeur émérite à Sciences Po Lyon, sous le titre : “Le Hirak face à la hiérarchie militaire”. Dans ce chapitre, Lahouari Addi décrit le bicéphalisme du régime algérien avec d’un côté le pouvoir formel incarné par le président et le gouvernement, et de l’autre le pouvoir réel détenu par les généraux.
En février 2019 a commencé en Algérie un mouvement massif de protestation qui a été étonnant par son ampleur, sa diversité sociale et sa durée.
Pendant près de deux ans, chaque vendredi après-midi, des manifestations pacifiques se déroulaient pour demander un changement de régime. Le mouvement a commencé à Kherrata, ville moyenne de l’Est du pays, où une foule nombreuse s’était rassemblée devant la mairie et a enlevé le portrait géant du président Bouteflika, qui était candidat pour la cinquième fois consécutive.
Déterminée, la foule a piétiné le portrait géant du président tombé à terre avec fracas. La scène a été virale sur les réseaux sociaux, et le vendredi suivant toutes les villes du pays ont connu une protestation similaire, exigeant le retrait de la candidature du vieux président âgé de 80 ans. Celui-ci apparaissait pendant des années à la télévision publique diminué, poussé sur une chaise roulante le regard hagard, incapable de parler. Le cinquième mandat d’un candidat handicapé physiquement et mentalement a été perçu par la majorité de la population comme une insulte et une atteinte à la dignité de l’État.
La spontanéité de la protestation populaire et l’occupation de l’espace public par des foules nombreuses ont été une réaction face à l’image dégradée du président qui est le symbole de l’État et de la nation. C’était la première fois depuis l’indépendance que le régime était contesté avec une telle ampleur. Débordés, les services de sécurité ne pouvaient pas s’opposer à des manifestants si nombreux qui comptaient dans leurs rangs des femmes, des enfants et des personnes âgées. Les manifestations n’étaient ni violentes, ni agressives. Au contraire, elles étaient joyeuses, marquées par des hymnes nationaux et des chansons militantes qui dénoncent la mal-vie des jeunes et la corruption des dirigeants.
Apparu dans les stades avant février 2019, le chant La Casa del Mouradia était devenu le cri de ralliement du mouvement. Pendant plus de deux ans, il n’y a pas eu une seule vitre brisée, une voiture incendiée ou un édifice public saccagé. Au contraire, en fin d’après- midi, des groupes de jeunes volontaires nettoyaient les chaussées et les trottoirs empruntés par les manifestants.
La colère ne visait ni l’État ni ses institutions. Elle exprimait juste une demande de changement. L’un des slogans les plus clamés au début était « djeich, chaab, khawa, khawa », comme pour dire que la protestation n’était pas dirigée contre l’armée en tant qu’institution.
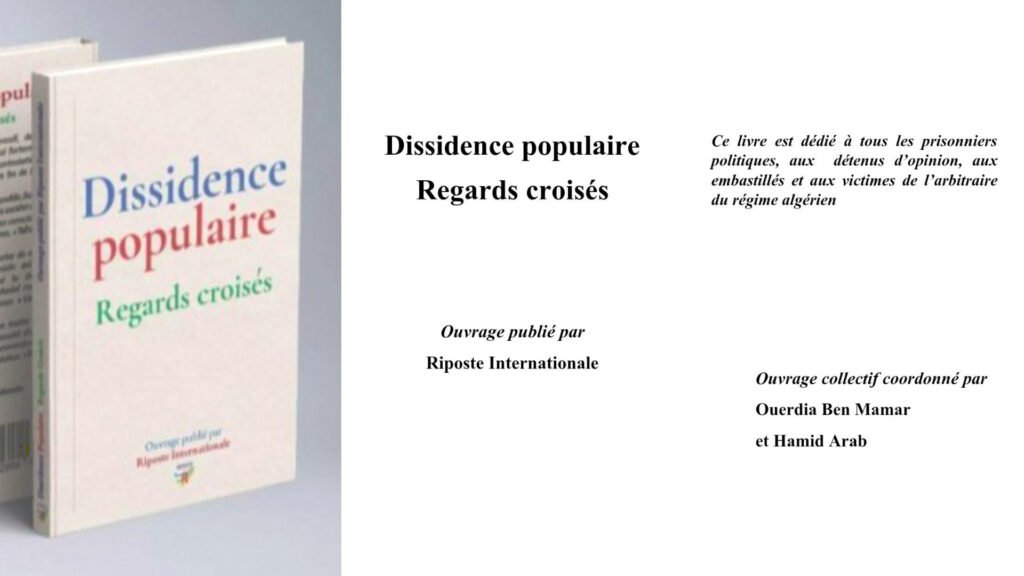
I
Les généraux ne s’attendaient pas à une telle réaction populaire inédite dans l’histoire du pays. Ils étaient habitués à une population résignée à accepter leur statut informel de « décideurs » qui ont forgé l’image d’un régime où l’armée est sous l’autorité du président élu au suffrage universel. Lorsque les médias officiels rendent compte des activités du président, ils mentionnent qu’il est « le chef suprême des armées » selon l’expression consacrée par la constitution. Ce besoin de rappeler constamment cette prérogative constitutionnelle cherche à cacher une réalité: le président n’a pas d’autorité sur l’armée malgré les dénégations du discours officiel.
Institution qui reçoit les impulsions du ministère de la Défense, la présidence n’est pas le centre névralgique où se prennent les décisions importantes. Dévitalisée, elle est la façade institutionnelle à travers laquelle le leadership militaire fixe les grands équilibres budgétaires et les lignes directrices de la politique étrangère. L’originalité du régime algérien est son bicéphalisme, c’est-à-dire qu’il y a deux centres de décision au sommet de l’État : l’un incarnant le pouvoir réel, et l’autre, formel, détenu par le président et le gouvernement. Le premier contrôle le second qui dirige l’administration gouvernementale.
La légitimité du pouvoir formel provient de l’autorité militaire et non de l’électorat. En janvier 1992, à l’issue de la victoire des islamistes aux élections législatives, le président Chadli Bendjedid était sur le point de nommer Abdelkader Hachani au poste de Premier ministre. Il a été poussé à la démission par la hiérarchie militaire qui n’approuvait pas cette décision. Son successeur, Mohamed Boudiaf, a été assassiné cinq mois après sa désignation, soupçonné de vouloir reconnaître la marocanité du Sahara occidental sans avoir consulté les chefs militaires. Le successeur, Liamine Zéroual, a dû jeter l’éponge en 1998 après avoir constaté que les généraux n’approuvaient pas ses démarches en vue d’une solution politique au conflit qui ensanglantait le pays depuis 1992. Le règne de Bouteflika a duré vingt ans parce qu’il n’avait à aucun moment contesté les prérogatives informelles du pouvoir réel.
Rejetant l’étiquette de « régime militaire » utilisée par l’opposition, les généraux refusent d’assumer officiellement leur rôle central dans l’État. Ils sollicitent des civils qu’ils investissent de l’autorité administrative pour diriger le pays. Lorsque le colonel Boumédiène a pris le pouvoir par la force, il a dû s’habiller en civil pour exercer les fonctions de Chef d’État. La culture politique dominante issue du mouvement national est antimilitariste, ce qui oblige les militaires à doter le régime d’une façade civile. Après la mort du colonel Boumédiène, le fondateur du régime, la hiérarchie militaire a toujours choisi un président sans charisme et sans forte personnalité. La crainte des officiers est de désigner un chef d’État qui devienne populaire et qui les mettrait sous son autorité.
L’impotence de Bouteflika, malade depuis 2005, correspondait à leurs vœux car ils ne voulaient pas qu’une institution de l’État, fut-elle la présidence, s’oppose à leur autorité.
La reconduction d’un président qui n’exerce pas ses fonctions ne gênait pas le fonctionnement d’un système de pouvoir où les militaires ont la prérogative de la décision souveraine. La présidence est une annexe du ministère de la Défense qui contrôle, à travers cette institution, les différents ministères, où un colonel dépendant du DRS (service d’espionnage) est en poste à titre de conseiller pour surveiller les activités du ministre pourtant choisi en amont pour sa docilité. La mission du DRS ne se limite pas à surveiller les cadres de l’administration gouvernementale. Elle s’étend aussi à la société civile qui s’exprime à travers les syndicats, les associations, la presse privée et les partis. La tâche principale, dans ce cas, est de neutraliser et d’étouffer tout foyer de contestation par la répression ou la cooptation. L’objectif est de façonner un champ politique artificiel sans rapport avec la société réelle. Des individus non représentatifs sont ainsi choisis pour figurer sur les listes électorales et dont la motivation est guidée par l’ascension sociale qu’offre un poste de député ou sénateur dont le salaire versé à vie est vingt fois supérieur au SMIG.
II
Issu du coup d’État en juin 1962 contre le GPRA, le système mis en place après l’indépendance repose sur une règle non écrite : l’armée est seule source du pouvoir. Cela signifie que c’est elle qui choisit le président et qui incarne la souveraineté populaire en lieu et place de l’électorat. Avant 1989, durant la période du parti unique, la suprématie de la hiérarchie militaire était quasi-institutionnelle par le nombre d’officiers qui siégeaient dans le comité central du FLN. Après la réforme constitutionnelle de 1989, qui a légalisé le multipartisme, elle devait être cachée. À cet effet, l’administration procède au trucage des élections pour éliminer les candidats qui n’auront pas eu l’agrément des services de sécurité.
Encouragés par leur victoire contre les islamistes qu’ils ont neutralisés par la violence et la ruse durant les années 1990, les généraux refusent toute expression politique qu’ils ne contrôlent pas. Les courants dits « laïcs » qui les ont soutenus contre le projet islamiste n’ont pas été pris en considération et n’ont pas eu suffisamment d’élus pour peser sur la nature du régime. Bien au contraire, les généraux cherchaient plutôt l’appui d’islamistes modérés qui accepteraient la suprématie de l’armée. Ils se sont accommodés d’un salafisme apolitique qui s’était converti dans ce qui a été appelé l’islamo-business.
Durant la période de Bouteflika, les généraux n’étaient inquiétés ni de l’intérieur du régime ni de l’extérieur. C’est pourquoi la candidature à un cinquième mandat d’un président diminué par la maladie ne semblait pas irréaliste. Mais les manifestations populaires du Hirak les ont ramenés à la réalité et leur ont rappelés qu’il y avait des limites à ne pas dépasser.
Un État doit aussi se déployer dans une symbolique de la puissance que l’image du président sur chaise roulante, contredisait. Le Hirak a été, de ce point de vue, une quête de fierté nationale que les dirigeants semblaient avoir perdue.
En refusant le cinquième mandat du président sortant, les manifestants jetaient aussi une lumière crue sur un théâtre d’ombres qui cachait le rôle politique prépondérant des militaires. Il enrayait la mécanique de cette structure qui soumettait le civil au militaire.
Pendant quelques semaines, les dirigeants ont menacé et accusé « la main étrangère » derrière les manifestants qui défiaient les autorités. Mais face à la détermination du mouvement, le discours officiel a changé, laissant entrevoir une prise de conscience du fossé qu’il y a entre des dirigeants en plein déni de la réalité et une population qui refusait un président virtuel.
Les décideurs ont compris que s’ils n’accédaient pas aux principales revendications des manifestants, le régime s’écroulerait. Il était alors nécessaire de s’adapter pour neutraliser les foules en faisant l’éloge du hirak et en annulant la candidature au cinquième mandat du président sortant.
Dès le mois de mars, le général Gaïd Salah, en sa qualité de chef d’état-major, a appelé le président à démissionner de ses fonctions, ce qu’il fit immédiatement. Un président intérimaire fut désigné selon les dispositions de la constitution, avec comme tâche d’organiser l’élection présidentielle prévue le 4 juillet 2019. Celle-ci n’a pas eu lieu sous la pression des marches populaires car les manifestants ne voulaient pas que le nouveau président soit élu par le bourrage des urnes.
À travers les nombreux discours qu’il faisait dans des casernes de l’intérieur du pays, le général Gaïd Salah répétait qu’il avait confiance dans le peuple, qu’il avait entendu ses revendications et compris ses frustrations. Il ajoutait cependant que les réformes nécessaires devaient se faire dans le cadre de la constitution pour ne pas mettre en danger la stabilité de la nation, soulignant le contexte géopolitique défavorable qu’exploiteraient les ennemis du pays pour semer le trouble.
Aussi, il insistait sur l’élection d’un président dont la tâche sera de rétablir la confiance entre l’État et la population. Il refusait la demande d’une transition menée par des personnalités indépendantes, craignant que le processus échappe au contrôle de l’armée. Le face-à-face a duré de longs mois sur fond de grave crise politique que les militaires espéraient surmonter en comptant sur la fatigue et la démobilisation progressive de la rue.
Ignorant les demandes du Hirak, les autorités ont fixé la date de l’élection présidentielle au 12 décembre 2019, tenant absolument à faire élire un président même avec un faible taux de participation au scrutin. Il fallait aux décideurs la légalité ou un semblant de légitimité électorale d’un chef d’État pour élaborer et mettre en place une stratégie de répression qui sera sélective et dissuasive. Si pendant plusieurs mois les services de sécurité ont eu des difficultés à contrecarrer les manifestants et à réprimer les marches, c’est parce que la légalité incarnée par un président élu faisait défaut. Cette légalité a été restaurée avec l’élection d’Abdelmadjid Tebboune supposé être légitime et ouvrant la voie à des poursuites judiciaires pour atteinte aux institutions et à l’ordre public.
Au fil des semaines, le nombre de manifestants diminuait pour différentes raisons. Certains manifestants se sont retirés par crainte d’être arrêtés ; d’autres ont estimé qu’il fallait donner une chance au nouveau président qui a affirmé qu’il entreprendrait les réformes nécessaires pour restaurer la dignité de l’État. D’autres encore craignaient que la continuation de la protestation ne profite aux islamistes ou à leurs adversaires.
Même si des enquêtes de terrain et des sondages d’opinions sont indisponibles, il n’y a aucune raison de croire que les millions de citoyens qui ont participé aux marches hebdomadaires pendant des mois avaient les mêmes attentes. Ils étaient unis par le refus du cinquième mandat, mais divergeaient sur la suite à donner au mouvement.
Certains manifestants étaient gênés de se trouver aux côtés des islamistes pour dénoncer le régime. L’élection présidentielle et surtout la pandémie du Covid-19 ont affaibli le mouvement dès le début de l’année 2020. Des appels à la suspension des marches hebdomadaires ont été lancés par des figures du Hirak par souci sanitaire. Les marches ont néanmoins repris à l’occasion du deuxième anniversaire du Hirak, en février 2021, mais elles se sont étiolées. Les services de sécurité ont profité du reflux de la protestation pour arrêter les figures qui avaient émergées lors des marches en les accusant de terrorisme. L’association Bab-El-Oued City a été dissoute et des centaines de personnes ont été incarcérées pour « activités subversives liées à des groupes terroristes » selon les motifs d’inculpation.
En dehors de la période des années 1990, l’Algérie n’avait jamais connu autant de détenus d’opinion que durant les années 2020-2022. La diaspora algérienne a aussi été concernée par les arrestations de personnes se rendant au pays. Beaucoup de personnes qui participaient aux rassemblements à l’étranger se sont abstenues de le faire de peur d’être inquiétées en cas de déplacement au pays.
Ayant cartographié le mouvement, les services de sécurité utilisaient leurs relais et informateurs pour faciliter la fragmentation du mouvement et ont joué la carte de la division entre islamistes et non-islamistes et entre radicaux et modérés. Il est à noter que les médias officiels n’ont jamais eu un discours hostile au Hirak ; au contraire, il était présenté comme un sursaut de la conscience politique de la population qui exigeait une épuration au sommet de l’État, ce qui a été fait par les décideurs selon les médias officiels. La radio et la télévision publiques expliquaient que le Hirak « béni » a permis à l’État de se renforcer avec un nouveau personnel civil intègre dont la mission est de mettre l’administration au service de la population.
Cependant, après l’élection présidentielle, ces médias dénonçaient le détournement du Hirak par les islamistes de l’organisation Rachad et par les berbéristes affiliés au parti séparatiste MAK.
III
Le régime déclarait que les objectifs du Hirak ont été atteints puisque « la ‘issaba », le gang de Bouteflika avait été démantelé et ses membres arrêtés. La presse publiait des articles et montrait des images des membres de « la ‘issaba », menottes en main, dont Saïd Bouteflika, le frère du président déchu, devenu le symbole du mal neutralisé. Les hommes d’affaires qu’ils avaient aidé à s’enrichir, étaient aussi arrêtés pour violation de la réglementation, financements occultes et trafic d’influence.
Le premier ministre en exercice au début de la contestation (Ahmed Ouyahia), son prédécesseur (Abdelmalek Sellal), plusieurs ministres et députés des deux partis du pouvoir et des dizaines d’hommes d’affaires ont été incarcérés et leurs biens confisqués. Le corps des officiers supérieurs a aussi été touché par les arrestations liées à des affaires de corruption. Une trentaine de généraux étaient soit en prison, soit en fuite à l’étranger.
Le régime a été ébranlé, mais il s’est maintenu en sacrifiant sa façade civile et en se délestant des généraux connus du grand public pour avoir amassé des fortunes grâce aux détournements, à l’instar des généraux Hamel et Belksir. Un nouveau discours s’était mis en place, accablant l’ancien président de tous les maux. À son décès, intervenu un an plus tard, il n’y a eu ni cérémonie officielle ni drapeaux en berne.
Des signes de divisions étaient apparus au sein de la hiérarchie militaire sur la stratégie à adopter face au Hirak, mais il n’y a pas eu la division entre ce que la science politique appelle les hardliners et les softliners. Il y a eu des frictions entre clans qui révélaient des rivalités qui existaient entre le chef d’état-major, le général Gaïd Salah, et l’ancien chef du DRS, le général Tewfik Médiène qui a été arrêté pendant quelques mois.
Dès la mort de Gaïd Salah, le clan rival est revenu en force, ralliant à lui les officiers qui craignaient qu’un nouveau régime ouvrirait les dossiers des années 1990 : (assassinats de Boudiaf, Merbah…, les affaires des disparus et de la torture). Des centaines d’officiers avaient peur de rendre des comptes devant des tribunaux qui les poursuivraient pour torture, disparitions forcées et exécutions extra-judiciaires.
Cette crainte a provoqué un réflexe de solidarité de corps parmi les militaires qui a été la cause du retour aux affaires d’officiers du DRS précédemment écartés. L’héritage des années 1990 est un obstacle à un changement de régime.
IV
Comment se fait-il qu’un mouvement de protestation qui a réuni des centaines de milliers de personnes chaque semaine durant des mois n’a pas abouti à un changement de régime? Il a été constaté par de nombreux observateurs et journalistes que dans les pays du Tiers-Monde, et en particulier dans le monde arabe, les protestations populaires ont des effets limités sur l’État et n’aboutissent pas aux changements demandés par les manifestants.
Le « printemps arabe » qui avait commencé en 2010 a mené à la tentation bonapartiste en Tunisie, au renforcement de l’autoritarisme en Égypte, à l’éclatement de la Syrie et de la Libye et à l’anarchie au Yémen. Ces échecs sont à mettre cependant dans une perspective historique dans des pays où la construction de l’État -nation est dans la phase patrimoniale, c’est-à-dire que l’autorité est détenue par une élite qui ne se considère pas concernée par l’alternance au pouvoir. L’élite dirigeante se conçoit comme une structure constitutive de l’État et sans laquelle l’État n’existerait pas. C’est la définition du régime néo-patrimonial où l’autorité publique n’a pas pour source l’électorat mais une institution, que ce soit la monarchie, l’armée ou le parti qui se pose comme l’incarnation de la nation. C’est le cas de l’Égypte, du Maroc, de la Syrie et aussi de l’Algérie où les généraux estiment qu’ils sont au-dessus de l’État dont ils seraient les protecteurs. La période postcoloniale a favorisé la mise en place d’une sorte de Protectorat autochtone qui écarte les citoyens du champ politique, limité à des acteurs qui se sentent investis d’une mission historique au-dessus des contingences de la vie quotidienne des administrés. Elle a façonné un rapport apolitique à l’État, réduit à ses fonctions administratives. Cette conception autoritaire refuse l’institutionnalisation des expressions politiques, considérant le pouvoir de l’État comme un attribut sacré et une fin en soi et non un moyen séculier au service de la gestion de l’espace public.
Il faut cependant se garder de croire que l’autoritarisme dans les pays arabes à un fondement culturel. Ces pays vivent une phase historique de la construction nationale où interviennent plusieurs facteurs, dont l’économie, la religion, l’idéologie, la géopolitique, etc. Le néo-patrimonialisme n’est pas une essence marquant une culture ; c’est un produit de l’histoire de pays où les dirigeants se légitiment par le combat passé pour l’indépendance. Au Maroc, la monarchie prétend avoir résisté au Protectorat français et arraché l’indépendance, ce qui fonderait sa légitimité atemporelle justifiée par une profondeur historique qui remonte à plusieurs siècles. En Égypte, les militaires se perçoivent comme des révolutionnaires qui ont fait tomber la monarchie qui avait livré le pays aux puissances étrangères.
Quant à l’Algérie, l‘armée se proclame l’héritière de l’ALN, se donnant une légitimité historique pour incarner la nation et exercer les prérogatives de la souveraineté. Mais ce n’est pas l’armée qui exerce la souveraineté puisque son personnel, de l’homme de troupe au colonel, n’est pas impliqué dans l’activité politique, à l’inverse des officiers généraux.
Le grade de général est une fonction politique qui ouvre l’accès au statut de Grand Électeur. En effet, le choix du président et les orientations politiques du régime sont décidées à l’intérieur de ce cercle fermé dont l’existence n’est ni institutionnelle ni prévue par la constitution. C’est dans cette instance informelle que se cristallise et se reproduit la culture néo-patrimoniale de décideurs qui choisissent le personnel civil qui dirige l’administration gouvernementale. Ils exercent un contrôle sur l’État et la société en détournant de leurs fonctions les services d’espionnage et de contre- espionnage à qui ils confient la mission de neutraliser l’opposition.
Le DRS est en effet, le bras séculier des généraux, jouant le rôle de police politique dont la mission est de défendre le régime contre l’opposition. Avec le temps, ce service est devenu vital pour les généraux qui sentent leurs intérêts politiques et leurs privilèges menacés par les demandes de liberté d’expression et d’autonomie de la justice. L’aspiration à la démocratie heurte la structure néo-patrimoniale du régime qui a façonné un champ politique par la violence l’État (police, justice) et par l’utilisation des finances publiques à des fins politiques.
La stratégie du régime néo-patrimonial est d’étouffer la société civile embryonnaire qui essaye d’exister à travers des associations et des syndicats en dépit d’un arsenal juridique liberticide. La société civile n’a pas la capacité nécessaire pour influer sur la politique gouvernementale ou sur le choix des élus dans les différentes assemblées. Ni les associations de patrons d’entreprises, ni les syndicats des travailleurs, n’ont la force de paralyser l’activité économique à l’échelle du pays pour obliger le pouvoir central à négocier un changement de régime.
Le patron du groupe Cevital, Issad Rabrab, qui emploie plusieurs milliers d’employés, a été arrêté pour avoir participé à des marches populaires du Hirak. Il a été libéré plusieurs mois plus tard sous la condition qu’il ne s’implique pas dans la politique et qu’il dissolve le quotidien Liberté dont il était le propriétaire.
Il est interdit aux hommes d’affaires d’utiliser leur influence comme ressource politique sous peine d’interdiction de leurs activités économiques. La pression sur eux est exercée à travers les administrations douanière et fiscale.
Si un patron d’entreprise privée exprime une opinion politique hostile au régime, des fonctionnaires des services de douanes et des impôts se présenteront pour lui signifier qu’il a violé la règlementation douanière ou fiscale en vigueur, ce qui lui vaut plusieurs années en prison. C’est le cas du jeune Nabil Mellah dont l’entreprise fabrique et exporte des produits pharmaceutiques.
À travers les services de l’État (douanes, impôts, police, justice…) le régime étouffe l’émergence des différents pouvoirs sociaux : économique, médiatique, universitaire, syndical… Les travailleurs n’ont pas le droit d’avoir des syndicats autonomes pour ne pas discréditer le syndicat officiel sous le contrôle de l’État, l’UGTA. Son secrétaire général a été arrêté suite à la campagne anti-corruption destinée à restaurer l’image de l’État. En l’occurrence, il s’agissait de crédibiliser l’UGTA concurrencée par des syndicats « illégaux » qui véhiculent les revendications des travailleurs.
Dans un tel régime autoritaire, les citoyens n’ont pas la possibilité légale de s’organiser en associations ou partis autonomes malgré le multipartisme.
Institutionnalisé à la suite des émeutes d’octobre 1988, celui-ci a été vidé de sa substance par les restrictions des libertés et le bourrage des urnes. Les partis d’opposition sont tolérés à condition qu’ils acceptent de faire de la figuration dans des assemblées qui approuvent des lois décidées en amont par le pouvoir exécutif. Ils renoncent à l’idée d’alternance électorale et doivent se soumettre à la règle non écrite du système : la hiérarchie militaire est seule source du pouvoir. Leur rôle se limite à critiquer le personnel civil du régime et à donner une image d’une vie parlementaire pluraliste.
La loyauté des partis d’opposition légaux au régime les empêche d’être populaires auprès de l’opinion publique. Par conséquent, les revendications s’expriment en dehors des institutions, souvent dans des émeutes locales, des grèves improvisées et des rassemblements de rue non autorisés par l’administration. En un mot, au lieu d’être absorbées par les institutions, la protestation se manifeste par la violence en dehors et contre l’État.
V
Au vu du durcissement du régime et du nombre des détenus d’opinion, le Hirak semble avoir échoué dans sa demande d’ouverture démocratique, mais il a cependant eu des conséquences et, pour cela, on ne peut parler d’échec. Il a réussi à faire effondrer l’ancienne façade civile du régime qu’il a affaibli idéologiquement et politiquement. Ses deux partis, le FLN et le RND, ont montré qu’ils n’avaient aucun ancrage populaire et qu’ils sont incapables de produire un discours cohérent en rapport avec les demandes sociales de la population.
La répression qui s’abat sur les activistes du Hirak et sur les journalistes, est un aveu de faiblesse qui indique que les décideurs ont peur que la contestation reprenne. Les services de sécurité et l’administration judiciaire sont utilisés comme des digues servant à empêcher le mécontentement de se manifester publiquement.
Le Hirak a poussé le régime vers une situation défensive qui contredit son discours sur la concorde nationale et la légitimité des institutions, dévoilant son caractère autoritaire.
La quasi-interdiction du journal Liberté, les pressions sur le quotidien El Watan, le harcèlement du groupe de presse Maghreb-Émergent indiquent que les autorités ne tolèrent plus une presse qui, à l’occasion des marches du Hirak, a pris l’habitude de publier des articles et des éditoriaux favorables au soulèvement populaire.
La victoire du Hirak est qu’il a mis dans le débat public la question de la place de l’armée dans le champ de l’État . Est-elle la branche militaire du pouvoir exécutif ou est-elle la source de légitimité du pouvoir exécutif ? L’analyse des slogans scandés pendant les marches, notamment madania machi ‘askaria, montre que la principale revendication des manifestants est la dépolitisation de la hiérarchie militaire, ce qui situe le hirak dans une dynamique qui cherche à rectifier une vicissitude héritée de l’histoire : la militarisation du politique.
L’Algérie est en train de vivre une crise de dépassement de l’héritage de la lutte anticoloniale qui, pour des raisons historiques, avait militarisé la demande de l’indépendance face à un pouvoir colonial radical qui ne comprenait que le langage de la violence.
Ce n’était certainement pas les notables nationalistes du parti de Ferhat Abbas qui allaient arracher l’indépendance. Cette tâche a été dévolue aux populistes révolutionnaires qui n’avaient pas d’autre choix que de militariser le politique. La militarisation du politique n’a pas cessé avec l’indépendance qui a donné l’occasion à l’appareil militaire de dominer le nouvel État en cachant cette domination par un discours populiste pseudo-révolutionnaire.
La militarisation du politique est en Algérie un accident de la construction nationale que les générations nées après l’indépendance veulent rectifier. Elles aspirent à l’autonomisation du politique appelé à se fondre dans des institutions qui véhiculent l’autorité publique.
La pacification du champ politique et l’institutionnalisation des rapports d’autorité dans la sphère de l’État passe obligatoirement par la dépolitisation de l’armée, et aussi la dépolitisation de la religion, de l’université, de l’économie, etc.
Ce n’est pas au nom du monopole sur les armes ou celui sur la parole de Dieu, et ce n’est pas au nom de la richesse ou de la science que l’État doit être dirigé. La dépolitisation de l’armée, de la religion… appartient à une dynamique d’autonomisation du champ politique qui obéira à ses propres règles, protégeant la représentativité des institutions qui suppose une légitimité électorale garantie par des opérations de vote organisées par une administration politiquement neutre, et protégées contre les fraudes par une justice indépendante du pouvoir exécutif.
Le Hirak est une volonté collective de passer du pré- politique, régulé par la violence, au politique logeant dans les institutions.
Le caractère pacifique de manifestations rassemblant des dizaines de milliers de personnes a été un signe de la demande de séparer la politique de la violence exercée par les services de sécurité sur la base de décisions administratives sans fondement juridique. Le slogan moukhabarates irhabia scandé par les manifestants signifie que les citoyens ne veulent plus que l’autorité publique soit exercée dans la clandestinité par des services qui ressemblent plus à des milices qu’à des institutions de l’État chargées de l’ordre public.
La dépolitisation du grade de général est le nœud gordien de la transition démocratique dans un pays où les services secrets de l’armée ont été détournés de leur mission officielle. Ces derniers jouent un rôle liberticide en créant une vie politique artificielle animée par des personnes occupant des fonctions électives pour des motifs d’enrichissement personnel et d’ascension sociale.
C’est pour avoir le monopole sur le politique que la hiérarchie militaire est hostile aux partis perçus comme des appareils qui cherchent à limiter son pouvoir régalien sur l’État. Mais la culture antiparti des militaires a un prix : la rupture entre les institutions et la société, et aussi la cristallisation du mécontentement populaire sur le grade de général. L’un des slogans chantés par les manifestants est significatif de ce rejet : «les généraux à la poubelle et l’Algérie sera indépendante ».
Réagissant à ce slogan, la hiérarchie militaire a eu recours à la répression, ce qui est une fausse solution à un vrai problème politique. Il n’y a pas que la rue qui demande la fin du pouvoir régalien de l’armée sur l’État. Des généraux à la retraite, malgré les menaces, se font écho de la nécessité de dépolitiser le grade de général pour mettre l’armée en dehors des protestations publiques.
L’arrestation du général Ali Ghediri est, significative à cet égard. Il s’était prononcé contre le cinquième mandat de Bouteflika avant le début du Hirak et avait annoncé sa candidature aux élections présidentielles en promettant de retirer l’armée du champ politique. Il a précisé qu’il appliquera le texte portant sur le départ à la retraite des officiers l’âge de 65 ans. Il a été arrêté et incarcéré sans jugement pour avoir évoqué publiquement la question du transfert de la souveraineté de la sphère militaire à la sphère civile.
Ali Ghediri est-il représentatif d’un courant dans l’armée ou est-il un officier qui fait l’unanimité contre lui parmi ses anciens collègues ?
Il aurait pu être l’homme de la transition que la hiérarchie militaire refuse, enfermée dans une contradiction de plus en plus insupportable.
D’un côté, le discours officiel affirme que l’armée est une institution apolitique et, d’un autre côté, c’est la hiérarchie militaire qui désigne le président et qui façonne une vie politique artificielle par le biais du DRS. Cette contradiction aurait pu être surmontée, si elle était cachée par un leader charismatique comme ce fut le cas avec le colonel Houari Boumédiène. Mais la hiérarchie militaire refuse l’émergence d’un tel leader même sorti de ses rangs, craignant qu’il érode ses pouvoirs et ses privilèges.
À l’exception de Mohamed Boudiaf qui a été assassiné cinq mois après sa désignation au poste de chef d’État, la hiérarchie militaire a toujours évité de choisir un président à forte personnalité attirant à lui le soutien populaire. Elle veut des institutions désincarnées, un État apolitique et une société docile.
Les civils nommés aux postes de responsabilité, sont tenus de remplir leurs tâches en respectant ce cadre idéologique qui leur retire l’autorité politique nécessaire pour diriger l’administration efficacement et de façon cohérente.
Quel poids a un ministre face à un général qu’il courtise pour être son protégé ? L’élite civile, qui joue le rôle de fusible, est par rapport aux militaires, dans une situation d’employés subordonnés à leur patron. C’est ce qui explique la rapidité et la vigueur avec lesquelles des ministres, des députés et des chefs de partis du pouvoir ont été arrêtés et incarcérés dès le début du Hirak. Il leur a été reproché d’avoir été incompétents dans l’exercice des responsabilités qui leur avaient été confiées. En faisant un mauvais usage de l’autorité de l’État et en étant incompétents, ils auraient éclaboussé les militaires en les mettant en lumière en tant qu’instance détenant les prérogatives de la souveraineté nationale.
Les anciens premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, condamnés à plusieurs années de prison, ont été considérés, non comme des hommes politiques, mais comme des personnes qui ont rompu leur contrat avec leur employeur pour avoir gaspillé les ressources dont ils avaient la gestion.
En conclusion, le Hirak a cherché à dépasser la contradiction majeure du régime en demandant la dépolitisation du grade de général pour mettre l’armée à l’abri de la contestation politique. Pour les manifestants, l’armée en tant qu’institution, n’a pas à rendre compte des échecs des politiques économiques et sociales du gouvernement. C’est le sens du slogan des manifestants « djeich-chaab, khawa-khawa ».
Dans cette perspective, la dépolitisation du grade de général mettra l’armée à l’abri des aléas de la gestion de l’État. Le Hirak a cherché à revenir sur un principe adopté par le Congrès de la Soummam : la primauté du politique sur le militaire.
Dans l’immédiat, la situation semble bloquée. Si le leadership militaire estime que le rapport de force politique est encore en sa faveur, il n’acceptera pas les revendications de changement de régime.
Lahouari Addi
Professeur émérite à Sciences Po Lyon


