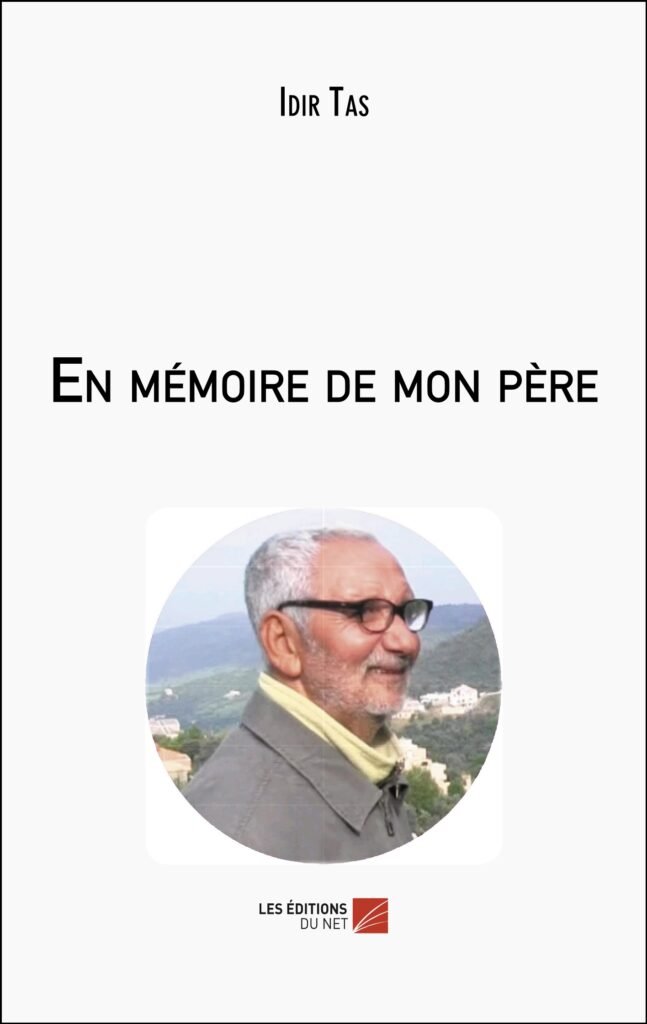Propos recueillis par Tahar Khalfoune
— En ce premier anniversaire de la disparition de ton père, Da Saïd, tu viens de publier aux éditions du Net un livre intitulé « En mémoire de mon père ». Pourquoi as-tu choisi de parler de ton père sous forme de petits tableaux mémoriels ?
— Parce que je me suis mis à l’écoute de mes souvenirs qui sont revenus selon leur logique propre, au fil des jours, à partir du moment où j’ai appris la mort de mon père. Ce sont d’abord les souvenirs qui m’ont marqué le plus profondément qui sont remontés à la surface, puis peu à peu, d’autres plus anecdotiques, plus récents ont resurgi. À la fin de l’écriture de ce récit, je me suis rendu compte en le relisant, qu’il y avait une trame beaucoup plus chronologique que ce que je pensais.
— Da Said un homme fort sympathique et discret, tu en fais un héros, pourquoi ?
— Oui, à mes yeux de petit garçon et encore plus d’homme (adulte), mon père était un héros, car même s’il n’a pas œuvré au premier plan, il a risqué sa vie à plusieurs reprises. À l’époque de la Guerre d’Algérie, il vivait à Paris et il était membre de l’OCFLN… Il faisait le guet lors des réunions des chefs de quartier, acheminait du courrier et parfois un peu d’argent venant des cotisations de nos concitoyens.
— (Ainsi), à travers le destin (singulier) d’un seul homme, c’est de toute une génération d’Algériens immigrés dont tu parles en vérité ?
— En effet, en même temps que j’ai essayé de comprendre quel rôle mon père a joué à son échelle, si modeste soit-elle, dans la grande Histoire du peuple algérien au moment où il se libérait du joug du colonial (isme), j’ai retrouvé toute une génération d’hommes qui ressemblaient peu ou prou à mon père et dont la jeunesse avait été sacrifiée par la guerre comme toute personne qui doit participer à un conflit et servir l’intérêt collectif, peu importe le pays et l’époque.
— Da Said a participé à la manifestation bien connue à Paris du 17 octobre 1961 noyée dans le sang par la préfet Maurice Papon. Dans ton récit tu rapportes l’infortune qui a frappé Zadri Mohand-Saïd, originaire du même du village que Da Said, At Saada, et tu as écrit que ton père était hanté par ce souvenir.
— Oui, mon père m’a très souvent parlé de cette histoire et à travers la gravité de sa voix, même si je n’étais encore qu’un enfant, j’ai compris et pris la mesure de la tragédie de l’évènement. Je revois la scène comme si j’y avais assisté. La police française avait lié les mains de Mohand-Saïd derrière son dos et lui avait ligoté les pieds, puis elle l’avait mis dans un sac et l’avait jeté du haut d’un pont dans la Seine. Heureusement que Mohand-Saïd cachait toujours un petit canif dans une de ses chaussettes. Il avait réussi à prendre son couteau et à couper ses liens et, comme c’était un bon nageur, il avait pu échapper à la noyade.
— tu rapportes un autre fait qui a touché particulièrement Da Said, à savoir l’exécution par des membres de l’OCFLN d’un partisan de Messali El-Hadj.
— Oui, mon père avait proposé à ce messaliste de payer sa cotisation à sa place, mais il avait refusé. Pour ce partisan, ce n’était pas une question d’argent, mais de principe. Mon père m’avait raconté que lors de son arrivée pour la première fois à Paris en automne 1956, ce messaliste l’avait bien accueilli et il lui avait même acheté une chemise en guise de bienvenue.
— Da Said qui n’est jamais allé à l’école, Akfadou était privé d’école pendant la colonisation, a fréquenté à Paris les cours du soir et il a exercé plusieurs métiers ; en mécanique, en parfumerie, comme plombier et comme économe à l’Ambassade américaine. Y a-t-il un travail qui lui plaisait plus qu’un autre ?
— C’est certainement celui qu’il faisait à l’ambassade des États-Unis. Selon les besoins du personnel diplomatique, il avait exercé plusieurs fonctions : aide-cuisinier, serveur, économe, organisateur de réception… Son supérieur hiérarchique était tellement satisfait de lui qu’il l’avait inscrit à des cours d’anglais. Il lui avait même demandé de l’accompagner à son retour aux États-Unis. Pour les papiers, il se serait occupé de tout. Sa femme et ses enfants l’auraient évidemment accompagné. L’idée de franchir en famille l’Atlantique et de fouler le sol du nouveau continent avait commencé à faire son chemin dans la tête de mon père, mais le sort en avait décidé autrement pour lui, puisqu’il avait été embauché à l’usine de moteurs-tracteurs de Constantine, la SONACOME.
— Tu racontes dans ton récit, qu’à sa retraite, Da Said vivait dans village à Akfadou et il qu’aimait bien s’occuper des oliviers et grimper aux arbres, même à un âge avancé…
— Oui, jusqu’au jour où il est tombé d’un olivier. Alors je lui ai demandé au téléphone : pourquoi montes-tu encore aux arbres, à ton âge ? Il m’a répondu que les olives bien exposées au soleil sont les plus belles et qu’il ne pouvait pas ne pas les cueillir.
— Dans ce livre commémoratif, tu évoques de nombreux moments de complicité avec ton père. Il y en a un qui m’a particulièrement touché, le moment où vous alliez ensemble au marché à Constantine.
— Oui, nous avions l’habitude d’aller au marché tous les vendredis matin et c’était comme un rituel. On nous prenait souvent pour deux frères. Cela nous amusait et renforçait notre complicité. J’aimais bien entendre mon père bavarder avec les vendeurs et le regarder choisir des fruits et des légumes avec des gestes méticuleux. Il était toujours de bonne humeur et il avait la conversation facile. En un mot, il avait du liant et j’appréciais ce trait de caractère.